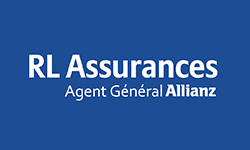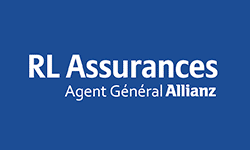Tahiti, le 17 juillet 2024 - La maison de naissance Tumu Ora a l’assurance, depuis peu, de pouvoir continuer son activité encore au moins trois ans. Pour les professionnelles de santé qui y exercent et les parents, c’est le soulagement. Le parcours de Sylvie Sippel, sage-femme, permet de mieux comprendre tout l’intérêt du lieu.
“On souffle”, reconnaît Sylvie Sippel. Elle est sage-femme et travaille depuis février à la maison de naissance Tumu Ora. Cet espace ouvert en 2021 était dans l’incertitude. Les professionnelles de santé et couples suivis ne savaient pas, il y encore quelques semaines, si la maison de naissance allait perdurer. “On a bataillé et remué les choses”, raconte Sylvie Sippel. Tous tenaient à Tumu Ora. Pas moins de 134 bébés y ont déjà vu le jour, accueillis par des parents comblés par l’accompagnement et les attentions.
Démédicaliser la grossesse et l’accouchement
Tumu Ora suit les futures mères dont la grossesse est physiologique, c’est-à-dire sans pathologie. Même si l’hôpital est à quelques mètres à pied seulement, il n’est pas question de prendre le moindre risque. L’idée, en ce lieu, est de suivre les parents autrement. Comme son nom l’indique, la maison de naissance se veut familière, accueillante et non médicalisée. Les appareils de surveillance, dissimulés, ne font aucun de bruit. “On a tout ce qu’il faut pour suivre les mamans de manière sécurisée, mais on les cache pour éviter que cela soit trop intrusif.” L’objectif de l’espace est de démédicaliser la grossesse et l’accouchement.
Tout au long de la grossesse, sages-femmes et futurs parents apprennent à se connaître, la maman s’interroge sur ce dont elle a vraiment envie pour elle et son bébé. Certaines femmes déjà mamans qui souhaitent accoucher à Tumu Ora disent avoir fait ce choix car elles ne s’étaient pas senties “écoutées” lors de leur précédente grossesse. Les sages-femmes donnent des clés pour que chaque mère apprenne à mieux connaître son corps, à détecter des signaux, à se faire confiance également surtout lorsque c’est une première grossesse. Le chemin permet aussi de se préparer aux douleurs attendues. Il n’y a pas de péridurale à la maison de naissance. Dans tous les cas, et malgré la préparation et la motivation, il est possible à tout moment de se rendre à l’hôpital, y compris une fois que le travail a commencé.
Les femmes qui font le choix de la maison de naissance évoquent en guise d’arguments l’attention et l’écoute de leurs envies mais aussi de leur corps, l’accompagnement personnalisé, la non-médicalisation et/ou le retour rapide à la maison. Il se fait 4 ou 5 heures après l’accouchement. “Ensuite, bien sûr on passe voir les familles chez elles tous les jours pendant au moins une semaine avant de couper le cordon”, plaisante Sylvie Sippel.
“On souffle”, reconnaît Sylvie Sippel. Elle est sage-femme et travaille depuis février à la maison de naissance Tumu Ora. Cet espace ouvert en 2021 était dans l’incertitude. Les professionnelles de santé et couples suivis ne savaient pas, il y encore quelques semaines, si la maison de naissance allait perdurer. “On a bataillé et remué les choses”, raconte Sylvie Sippel. Tous tenaient à Tumu Ora. Pas moins de 134 bébés y ont déjà vu le jour, accueillis par des parents comblés par l’accompagnement et les attentions.
Démédicaliser la grossesse et l’accouchement
Tumu Ora suit les futures mères dont la grossesse est physiologique, c’est-à-dire sans pathologie. Même si l’hôpital est à quelques mètres à pied seulement, il n’est pas question de prendre le moindre risque. L’idée, en ce lieu, est de suivre les parents autrement. Comme son nom l’indique, la maison de naissance se veut familière, accueillante et non médicalisée. Les appareils de surveillance, dissimulés, ne font aucun de bruit. “On a tout ce qu’il faut pour suivre les mamans de manière sécurisée, mais on les cache pour éviter que cela soit trop intrusif.” L’objectif de l’espace est de démédicaliser la grossesse et l’accouchement.
Tout au long de la grossesse, sages-femmes et futurs parents apprennent à se connaître, la maman s’interroge sur ce dont elle a vraiment envie pour elle et son bébé. Certaines femmes déjà mamans qui souhaitent accoucher à Tumu Ora disent avoir fait ce choix car elles ne s’étaient pas senties “écoutées” lors de leur précédente grossesse. Les sages-femmes donnent des clés pour que chaque mère apprenne à mieux connaître son corps, à détecter des signaux, à se faire confiance également surtout lorsque c’est une première grossesse. Le chemin permet aussi de se préparer aux douleurs attendues. Il n’y a pas de péridurale à la maison de naissance. Dans tous les cas, et malgré la préparation et la motivation, il est possible à tout moment de se rendre à l’hôpital, y compris une fois que le travail a commencé.
Les femmes qui font le choix de la maison de naissance évoquent en guise d’arguments l’attention et l’écoute de leurs envies mais aussi de leur corps, l’accompagnement personnalisé, la non-médicalisation et/ou le retour rapide à la maison. Il se fait 4 ou 5 heures après l’accouchement. “Ensuite, bien sûr on passe voir les familles chez elles tous les jours pendant au moins une semaine avant de couper le cordon”, plaisante Sylvie Sippel.
“C’est très touchant”
Sylvie Sippel, qui d’une certaine manière redécouvre son métier en abordant la grossesse et la naissance autrement, se plaît à accompagner le cheminement de ses patientes. “Il y a toute une évolution émotionnelle et intellectuelle.” Depuis son arrivée, elle prend conscience de la volonté et de l’envie des pères d’être plus présents, de s’impliquer. “Ils sont en demande, sans pouvoir parfois le verbaliser, sans même parfois le savoir eux-mêmes.” Les hommes disent parfois devenir pères lorsqu’ils portent leur enfant dans leurs bras pour la première fois. À la maison de naissance, ils ont une place avant l’accouchement, suivant de près les transformations du corps de leur compagne, entendant leurs doutes et inquiétudes, trouvant une place pour les aider à gérer leurs douleurs. Ainsi, ils créent naturellement un lien avec l’enfant avant même de le rencontrer. “C’est très touchant.”
Sylvie Sippel est née à Salon-de-Provence en 1986. Elle y a grandi avant de suivre ses études à Marseille. Sa mère lui rappelle qu’elle avait verbalisé très jeune l’envie de travailler auprès des enfants. “Et puis j’ai oublié, et comme tout le monde, j’ai souhaité devenir institutrice et hôtesse de l’air.” Elle est revenue à ses premières envies tard, et “par hasard”. Elle s’est engagée dans une filière scientifique, “alors que mes professeurs ne m’y voyaient pas du tout !” Puis elle s’est inscrite en médecine. “Je n’ai pas assez travaillé la première année”, reconnaît-elle. Elle a refait une première année, mis les bouchées doubles et obtenu une place en médecine. “Mais je ne m’y voyais pas.” La pédiatrie ne l’emballait pas. “Je ne pouvais pas imaginer passer ma vie auprès d’enfants malades.” La gynécologie non plus, “j’apercevais le côté pathologique et obstétrical des grossesses.” Bien sûr, en tant que sage-femme, elle côtoie la maladie et la mort. “Cela fait partie de la vie.” Mais ce n’est pas son quotidien.
“On était testées”
Elle a donc opté pour des études de sage-femme. Quatre années difficiles. “Il faut avoir les reins solides.” Ce n’est ni la théorie, ni le terrain qui ont été pénibles, mais le management des équipes pendant les stages. “Les sages-femmes qui nous encadraient nous menaient la vie dure. On était testées. Elles cherchaient peut-être de cette manière à nous préparer à la suite, aux heures de garde qui s’enchaînent par exemple, la fatigue, la pression...” Depuis, l’encadrement semble avoir évolué à en croire les sages-femmes en cours de formation. “Sans doute se laissent-elles moins faire.”
Après ses études et ses stages, Sylvie Sippel a trouvé du travail dans la maternité où elle est née. Elle a eu une offre à la clinique de Marseille, mais le protocole en clinique ne lui plaisait pas. “Les sages-femmes suivent l’accouchement mais doivent céder la place au gynécologue au dernier moment, quand le bébé arrive.” Elle est restée sept années à Salon-de-Provence. Puis, un jour, elle a répondu à son irrépressible envie de voyager.
Au cours de ses études, elle avait fait un stage au Sénégal, elle envisageait un temps de faire de l’humanitaire. “Mais finalement, je ne voulais pas de ça toute une vie.” Petite, un voisin qui vivait six mois en France, six mois en Nouvelle-Calédonie, l’avait fait rêver. “Je me suis toujours dit qu’un jour, moi aussi j’irai.” En 2017, elle a réalisé son rêve. Elle a demandé une mise en disponibilité pour “partir à l’aventure”. Pendant quatre mois, elle a dû faire des petits boulots avant qu’un poste de sage-femme ne s’ouvre. Elle a travaillé à Nouméa, puis a saisi une opportunité à Wallis où elle est restée un an. Les patientes de Futuna devaient quitter leur île plusieurs semaines avant l’accouchement pour pouvoir être suivie de près à Wallis. “On vivait pour ainsi dire ensemble, j’ai eu, là, ma première expérience d’approche globale de la grossesse.”
Envie d’autre chose
Fin 2020, elle est finalement partie pour Tahiti pour des raisons personnelles. Elle a intégré un cabinet de sages-femmes libérales à Punaauia où elle a beaucoup appris. “Je me suis vraiment régalée mais j’avais envie d’autre chose que des remplacements.” Une place s’est faite à la maison de naissance.
Au début, elle a beaucoup observé. “Je n’étais pas formée à ce genre d’accompagnement.” Les futures mères peuvent compter sur la relaxation ou encore l’hypnose pour gérer leurs douleurs, elles participent à toutes les prises de décisions qui les concernent. “Je me suis trouvée un peu désarmée car c’est presque à l’opposé de tout ce que j’avais appris à l’école.” Après six mois d’expérience, Sylvie Sippel a pris de l’assurance. Elle constate : “À Tumu Ora, on redonne leur pouvoir aux parents.” Et au bout de 14 ans de pratique professionnelle, “ça fait vraiment du bien”.
Sylvie Sippel, qui d’une certaine manière redécouvre son métier en abordant la grossesse et la naissance autrement, se plaît à accompagner le cheminement de ses patientes. “Il y a toute une évolution émotionnelle et intellectuelle.” Depuis son arrivée, elle prend conscience de la volonté et de l’envie des pères d’être plus présents, de s’impliquer. “Ils sont en demande, sans pouvoir parfois le verbaliser, sans même parfois le savoir eux-mêmes.” Les hommes disent parfois devenir pères lorsqu’ils portent leur enfant dans leurs bras pour la première fois. À la maison de naissance, ils ont une place avant l’accouchement, suivant de près les transformations du corps de leur compagne, entendant leurs doutes et inquiétudes, trouvant une place pour les aider à gérer leurs douleurs. Ainsi, ils créent naturellement un lien avec l’enfant avant même de le rencontrer. “C’est très touchant.”
Sylvie Sippel est née à Salon-de-Provence en 1986. Elle y a grandi avant de suivre ses études à Marseille. Sa mère lui rappelle qu’elle avait verbalisé très jeune l’envie de travailler auprès des enfants. “Et puis j’ai oublié, et comme tout le monde, j’ai souhaité devenir institutrice et hôtesse de l’air.” Elle est revenue à ses premières envies tard, et “par hasard”. Elle s’est engagée dans une filière scientifique, “alors que mes professeurs ne m’y voyaient pas du tout !” Puis elle s’est inscrite en médecine. “Je n’ai pas assez travaillé la première année”, reconnaît-elle. Elle a refait une première année, mis les bouchées doubles et obtenu une place en médecine. “Mais je ne m’y voyais pas.” La pédiatrie ne l’emballait pas. “Je ne pouvais pas imaginer passer ma vie auprès d’enfants malades.” La gynécologie non plus, “j’apercevais le côté pathologique et obstétrical des grossesses.” Bien sûr, en tant que sage-femme, elle côtoie la maladie et la mort. “Cela fait partie de la vie.” Mais ce n’est pas son quotidien.
“On était testées”
Elle a donc opté pour des études de sage-femme. Quatre années difficiles. “Il faut avoir les reins solides.” Ce n’est ni la théorie, ni le terrain qui ont été pénibles, mais le management des équipes pendant les stages. “Les sages-femmes qui nous encadraient nous menaient la vie dure. On était testées. Elles cherchaient peut-être de cette manière à nous préparer à la suite, aux heures de garde qui s’enchaînent par exemple, la fatigue, la pression...” Depuis, l’encadrement semble avoir évolué à en croire les sages-femmes en cours de formation. “Sans doute se laissent-elles moins faire.”
Après ses études et ses stages, Sylvie Sippel a trouvé du travail dans la maternité où elle est née. Elle a eu une offre à la clinique de Marseille, mais le protocole en clinique ne lui plaisait pas. “Les sages-femmes suivent l’accouchement mais doivent céder la place au gynécologue au dernier moment, quand le bébé arrive.” Elle est restée sept années à Salon-de-Provence. Puis, un jour, elle a répondu à son irrépressible envie de voyager.
Au cours de ses études, elle avait fait un stage au Sénégal, elle envisageait un temps de faire de l’humanitaire. “Mais finalement, je ne voulais pas de ça toute une vie.” Petite, un voisin qui vivait six mois en France, six mois en Nouvelle-Calédonie, l’avait fait rêver. “Je me suis toujours dit qu’un jour, moi aussi j’irai.” En 2017, elle a réalisé son rêve. Elle a demandé une mise en disponibilité pour “partir à l’aventure”. Pendant quatre mois, elle a dû faire des petits boulots avant qu’un poste de sage-femme ne s’ouvre. Elle a travaillé à Nouméa, puis a saisi une opportunité à Wallis où elle est restée un an. Les patientes de Futuna devaient quitter leur île plusieurs semaines avant l’accouchement pour pouvoir être suivie de près à Wallis. “On vivait pour ainsi dire ensemble, j’ai eu, là, ma première expérience d’approche globale de la grossesse.”
Envie d’autre chose
Fin 2020, elle est finalement partie pour Tahiti pour des raisons personnelles. Elle a intégré un cabinet de sages-femmes libérales à Punaauia où elle a beaucoup appris. “Je me suis vraiment régalée mais j’avais envie d’autre chose que des remplacements.” Une place s’est faite à la maison de naissance.
Au début, elle a beaucoup observé. “Je n’étais pas formée à ce genre d’accompagnement.” Les futures mères peuvent compter sur la relaxation ou encore l’hypnose pour gérer leurs douleurs, elles participent à toutes les prises de décisions qui les concernent. “Je me suis trouvée un peu désarmée car c’est presque à l’opposé de tout ce que j’avais appris à l’école.” Après six mois d’expérience, Sylvie Sippel a pris de l’assurance. Elle constate : “À Tumu Ora, on redonne leur pouvoir aux parents.” Et au bout de 14 ans de pratique professionnelle, “ça fait vraiment du bien”.