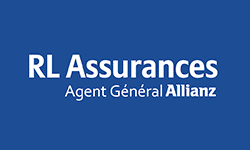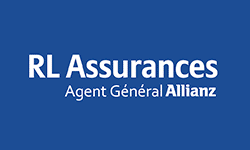PAPEETE, le 20 octobre 2014 - Jean-Claude Guillebaud est grand reporter pour Sud-Ouest, Le Monde et le Nouvel Observateur. Il a couvert les conflits à travers le monde, notamment au Vietnam, en Éthiopie, au Cambodge ou au Bangladesh. Il a aussi effectué de nombreux reportages en Outre-mer, qui l’ont conduit à écrire un livre qui a encore un écho aujourd’hui : Les Confettis de l’Empire. Entretien.
Comment devient-on grand reporter ? Pour Jean-Claude Guillebaud c’est arrivé presque par erreur. Travaillant pour le journal régional Sud-Ouest, il est envoyé très jeune couvrir le conflit de la Guerre du Biafra, au Nigéria. Au bout d’un mois il est kidnappé par l’armée, qui l’accuse d’espionnage et le menace d’exécution. Sorti de là par une organisation humanitaire, il revient en France avec un statut de star et son journal le nommera grand reporter. En 1972, il décroche le prix Albert-Londres et part travailler à Paris pour le journal Le Monde.
À propos des conférences, le journaliste explique : « On m’a demandé de parler aux étudiants en journalisme. Évidemment, j’ai été pendant presque 20 ans reporter de guerre, donc je vais leur raconter comment on essaie d’exercer ce métier le mieux possible. Et puis je vais leur dire comment j’ai commencé par la Polynésie française il y a bien longtemps. De 1973 à 1982 j’ai passé mon temps entre la Nouvelle Calédonie, la Polynésie, les Antilles, la Guyane, la Réunion, les Comores, Djibouti, etc. J’ai fait ce job avec passion. »
Pour lui, un reporter de guerre n’est plus une sorte de James Bond qui boit du whisky en draguant les hôtesses de l’air : « comme Florence Aubenas qui est venue il n’y a pas très longtemps, on n’aime pas trop cette vision hollywoodienne du reporter de guerre, ce journaliste un peu exhibitionniste "je suis sous les bombes au moment où je vous parle", ce n’est pas notre truc. On a plus de recul et envie d’être proche des gens. » Dans sa vision du métier, il évite de mettre en avant le danger, mais il souligne qu’il y a des difficultés morales : « pendant une famine ou une guerre, on est assailli par les demandes d’aides. On se sent un peu voyeur, d’autant qu’au bout d’un moment on les quitte, on rentre à la base ou à l’hôtel et on va manger normalement en abandonnant les gens dans leur malheur, et ça c’est très dur à gérer. »
Le journalisme en crise
« L’impopularité du métier de journaliste ne date pas d’hier, mais ça dépend comment on pose la question. Si on demande aux gens en quel métier ils ont le plus confiance, le journalisme arrive avant-dernier, devant les politiques. Mais dans les métiers qu’ils rêvent de faire, le journalisme est en première position. C’est paradoxal, mais quand on y pense c’est le seul métier où on peut avoir 50 vies qui s’additionnent, parce qu’on vit des tas de choses différentes… Un de mes premiers chefs de service m’avait dit un jour quand je suis devenu jeune journaliste : "Jean-Claude si vous n’avez pas la curiosité des gens, ce n’est pas la peine de faire ce métier" et ça c’est formidable. »
Mais son constat sur l’état de la presse en France est terrible. Les difficultés économiques de la presse écrite en France (comme en Polynésie) lui ferait perdre de l’indépendance au fur et mesure que les grands capitalistes rachètent les plus grand titres nationaux, et le métier de journaliste est de plus en plus prolétarisé. Du coup, « les gens se détournent des journalistes parce qu’ils n’ont plus confiance. Le métier se porte très mal, avec un correctif très important quand même : aujourd’hui je ne suis plus jeune journaliste, je suis membre du jury Albert-Londres depuis 8 ans. Et je constate depuis 8 ans que la qualité s’améliore de façon incroyable. Souvent il y a des enquêtes qui sont plus fouillées qu’il y a 20 ans, plus courageuses, plus indépendantes. » Mais pour lui, « dans l’histoire il y a plusieurs périodes où la presse se portait mal, et à chaque fois on s’en est sortis. »
Les Confettis de l’Empire : un livre animé par la rage
Après son passage au Sud-Ouest, Jean-Claude Guillebaud est arrivé au Monde, où il était grand reporter mais aussi en charge des territoires et départements d’Outre-mer. C’est là qu’il a consacré plusieurs années aux DOM-TOM, en commençant par la Polynésie en 1973 avec les premières grandes manifestations contre les essais nucléaires à Mururoa : « pour dire la vérité, quand je suis arrivé pour la première fois, pour le jeune homme que j’étais, j’ai découvert le colonialisme comme il devait exister dans mon esprit dans les années 40 : archaïque. J’avais l’impression de rêver, avec le mépris des gens, l’arrogance des blancs… J’étais sidéré. »
« La première fois que je suis arrivé en Nouvelle Calédonie, le Haut-commissaire de l’époque, Louis Verger, m’a convoqué dans son bureau et m’a récité ma fiche de police, pour me montrer qu’il savait qui j’étais, et il m’a dit cette phrase qui m’a mis en fureur : "Je vous dis une chose, ici si ça bouge – il parlait des kanaks – je cogne." Entendre ça, j’avais l’impression d’être transporté dans les années 30, donc j’ai nourri une espèce de colère rageuse de voir mon Pays, la France, se comporter de manière aussi archaïque et stupide. Du coup on m’a demandé de faire un livre, et j’ai appelé ça "Les Confettis de l’Empire", et il est animé par la rage. »
Comment devient-on grand reporter ? Pour Jean-Claude Guillebaud c’est arrivé presque par erreur. Travaillant pour le journal régional Sud-Ouest, il est envoyé très jeune couvrir le conflit de la Guerre du Biafra, au Nigéria. Au bout d’un mois il est kidnappé par l’armée, qui l’accuse d’espionnage et le menace d’exécution. Sorti de là par une organisation humanitaire, il revient en France avec un statut de star et son journal le nommera grand reporter. En 1972, il décroche le prix Albert-Londres et part travailler à Paris pour le journal Le Monde.
À propos des conférences, le journaliste explique : « On m’a demandé de parler aux étudiants en journalisme. Évidemment, j’ai été pendant presque 20 ans reporter de guerre, donc je vais leur raconter comment on essaie d’exercer ce métier le mieux possible. Et puis je vais leur dire comment j’ai commencé par la Polynésie française il y a bien longtemps. De 1973 à 1982 j’ai passé mon temps entre la Nouvelle Calédonie, la Polynésie, les Antilles, la Guyane, la Réunion, les Comores, Djibouti, etc. J’ai fait ce job avec passion. »
Pour lui, un reporter de guerre n’est plus une sorte de James Bond qui boit du whisky en draguant les hôtesses de l’air : « comme Florence Aubenas qui est venue il n’y a pas très longtemps, on n’aime pas trop cette vision hollywoodienne du reporter de guerre, ce journaliste un peu exhibitionniste "je suis sous les bombes au moment où je vous parle", ce n’est pas notre truc. On a plus de recul et envie d’être proche des gens. » Dans sa vision du métier, il évite de mettre en avant le danger, mais il souligne qu’il y a des difficultés morales : « pendant une famine ou une guerre, on est assailli par les demandes d’aides. On se sent un peu voyeur, d’autant qu’au bout d’un moment on les quitte, on rentre à la base ou à l’hôtel et on va manger normalement en abandonnant les gens dans leur malheur, et ça c’est très dur à gérer. »
Le journalisme en crise
« L’impopularité du métier de journaliste ne date pas d’hier, mais ça dépend comment on pose la question. Si on demande aux gens en quel métier ils ont le plus confiance, le journalisme arrive avant-dernier, devant les politiques. Mais dans les métiers qu’ils rêvent de faire, le journalisme est en première position. C’est paradoxal, mais quand on y pense c’est le seul métier où on peut avoir 50 vies qui s’additionnent, parce qu’on vit des tas de choses différentes… Un de mes premiers chefs de service m’avait dit un jour quand je suis devenu jeune journaliste : "Jean-Claude si vous n’avez pas la curiosité des gens, ce n’est pas la peine de faire ce métier" et ça c’est formidable. »
Mais son constat sur l’état de la presse en France est terrible. Les difficultés économiques de la presse écrite en France (comme en Polynésie) lui ferait perdre de l’indépendance au fur et mesure que les grands capitalistes rachètent les plus grand titres nationaux, et le métier de journaliste est de plus en plus prolétarisé. Du coup, « les gens se détournent des journalistes parce qu’ils n’ont plus confiance. Le métier se porte très mal, avec un correctif très important quand même : aujourd’hui je ne suis plus jeune journaliste, je suis membre du jury Albert-Londres depuis 8 ans. Et je constate depuis 8 ans que la qualité s’améliore de façon incroyable. Souvent il y a des enquêtes qui sont plus fouillées qu’il y a 20 ans, plus courageuses, plus indépendantes. » Mais pour lui, « dans l’histoire il y a plusieurs périodes où la presse se portait mal, et à chaque fois on s’en est sortis. »
Les Confettis de l’Empire : un livre animé par la rage
Après son passage au Sud-Ouest, Jean-Claude Guillebaud est arrivé au Monde, où il était grand reporter mais aussi en charge des territoires et départements d’Outre-mer. C’est là qu’il a consacré plusieurs années aux DOM-TOM, en commençant par la Polynésie en 1973 avec les premières grandes manifestations contre les essais nucléaires à Mururoa : « pour dire la vérité, quand je suis arrivé pour la première fois, pour le jeune homme que j’étais, j’ai découvert le colonialisme comme il devait exister dans mon esprit dans les années 40 : archaïque. J’avais l’impression de rêver, avec le mépris des gens, l’arrogance des blancs… J’étais sidéré. »
« La première fois que je suis arrivé en Nouvelle Calédonie, le Haut-commissaire de l’époque, Louis Verger, m’a convoqué dans son bureau et m’a récité ma fiche de police, pour me montrer qu’il savait qui j’étais, et il m’a dit cette phrase qui m’a mis en fureur : "Je vous dis une chose, ici si ça bouge – il parlait des kanaks – je cogne." Entendre ça, j’avais l’impression d’être transporté dans les années 30, donc j’ai nourri une espèce de colère rageuse de voir mon Pays, la France, se comporter de manière aussi archaïque et stupide. Du coup on m’a demandé de faire un livre, et j’ai appelé ça "Les Confettis de l’Empire", et il est animé par la rage. »