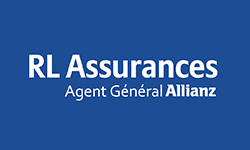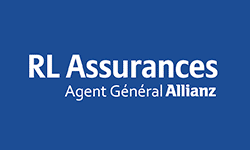Tahiti, le 12 novembre 2021 - La “quatrième Chine”, comme est parfois appelée Singapour, veille à garder ses distances avec Pékin, son marteau et sa faucille, mais n’en renie pas pour autant ses origines ethniques. Ville créée de toutes pièces par les Britanniques, mais très vite à majorité chinoise, Singapour renferme deux quartiers peut-être plus “chinois” que les autres, Waterloo Street et Chinatown. En route pour une balade colorée...
A Singapour, on est avant tout Chinois : mais Chinois de bonne compagnie, entendez par là sans aucune velléité vis-à-vis de ses voisins. La cité-État de plus de six millions d’habitants (presque six millions trois cent mille résidents aujourd’hui) n’a aucune intention de marcher sur les pieds de la Malaisie ou de l’Indonésie, mais elle n’entend pas non plus se laisser marcher sur les pieds par un grand voisin, fusse la Chine communiste, qui se montre extrêmement agressive dans la région depuis quelques années.
A Singapour, on est avant tout Chinois : mais Chinois de bonne compagnie, entendez par là sans aucune velléité vis-à-vis de ses voisins. La cité-État de plus de six millions d’habitants (presque six millions trois cent mille résidents aujourd’hui) n’a aucune intention de marcher sur les pieds de la Malaisie ou de l’Indonésie, mais elle n’entend pas non plus se laisser marcher sur les pieds par un grand voisin, fusse la Chine communiste, qui se montre extrêmement agressive dans la région depuis quelques années.

Aux abords de Waterloo Street, les échoppes ne se comptent plus. Bonnes affaires ou camelote, on trouve de tout.
Croyances, langues, coutumes...
A ce titre, et c’est l’objet de nos “cartes postales” très chinoises d’aujourd’hui, Singapour, avec un peu plus de 74 % de population d’origine chinoise (continentale), n’hésite pas à affirmer haut et fort son attachement à une culture millénaire (tout en respectant les deux principales autres ethnies présentes, les Malais et les Indiens). Et si le béton, le verre et l’acier dominent aujourd’hui l’architecture futuriste de la ville, il n’en demeure pas moins que celle-ci a su garder bien vivantes ses croyances, langues, dialectes et coutumes chinoises, exacerbés dans certains quartiers, comme Waterloo Street et les petites rues adjacentes. C’est à n’en pas douter là que le cœur chinois de Singapour bat avec le plus d’intensité sept jours sur sept. Notre promenade commence ici...
Waterloo, plus de 40 ans après...
Waterloo Street a été tracée en 1837, autant dire au tout début de la conception et de la construction de Singapour. Elle s’appelait alors Church Street, non pas à cause de la présence d’une quelconque église, mais plus simplement parce qu’elle portait le nom de Thomas Church, conseiller résident de la cité cette même année.
L’urbaniste était alors J.T. Thomson, très lié avec Church à qui il offrit ce clin d’œil en baptisant la rue de son nom.
Les Anglais étant ce qu’ils sont, non seulement ils mirent la pâté aux Français à Waterloo, mais ils s’en vantèrent jusqu’en Asie du Sud-Est rebaptisant Church Street en Waterloo Street en 1858, manière de marquer le coup après la victoire en 1815 de Wellington sur Napoléon. Plus de quarante ans après, c’est un rien mesquin, on vous l’accorde, mais bon, les British sont les British et quand ils peuvent tacler les Français, ils ne se gênent pas pour le faire, même à retardement...
A ce titre, et c’est l’objet de nos “cartes postales” très chinoises d’aujourd’hui, Singapour, avec un peu plus de 74 % de population d’origine chinoise (continentale), n’hésite pas à affirmer haut et fort son attachement à une culture millénaire (tout en respectant les deux principales autres ethnies présentes, les Malais et les Indiens). Et si le béton, le verre et l’acier dominent aujourd’hui l’architecture futuriste de la ville, il n’en demeure pas moins que celle-ci a su garder bien vivantes ses croyances, langues, dialectes et coutumes chinoises, exacerbés dans certains quartiers, comme Waterloo Street et les petites rues adjacentes. C’est à n’en pas douter là que le cœur chinois de Singapour bat avec le plus d’intensité sept jours sur sept. Notre promenade commence ici...
Waterloo, plus de 40 ans après...
Waterloo Street a été tracée en 1837, autant dire au tout début de la conception et de la construction de Singapour. Elle s’appelait alors Church Street, non pas à cause de la présence d’une quelconque église, mais plus simplement parce qu’elle portait le nom de Thomas Church, conseiller résident de la cité cette même année.
L’urbaniste était alors J.T. Thomson, très lié avec Church à qui il offrit ce clin d’œil en baptisant la rue de son nom.
Les Anglais étant ce qu’ils sont, non seulement ils mirent la pâté aux Français à Waterloo, mais ils s’en vantèrent jusqu’en Asie du Sud-Est rebaptisant Church Street en Waterloo Street en 1858, manière de marquer le coup après la victoire en 1815 de Wellington sur Napoléon. Plus de quarante ans après, c’est un rien mesquin, on vous l’accorde, mais bon, les British sont les British et quand ils peuvent tacler les Français, ils ne se gênent pas pour le faire, même à retardement...

L’entrée du Kwan Im Thong Hood Cho Temple en début d’après-midi, en pleine semaine. “Full”. Le week-end, il y a beaucoup plus de monde !
La foule tous les jours
Waterloo Street était plus longue initialement qu’elle ne l’est aujourd’hui car l’urbanisme a modifié très largement la cité et la construction du campus de la Singapore Management University (et de la station de métro du coin) a nécessité un petit coup de ciseau.
Une chose à savoir sur Waterloo Street : elle “affiche complet” tous les après-midis, c’est clair, mais les week-ends et les jours fériés, c’est pire encore. La foule y est d’une extravagante densité, se partageant entre un centre commercial (au nord), le Kwan Im Thong Hood Cho Temple et un nombre impressionnant de boutiques vendant aussi bien de l’artisanat chinois (de grande qualité, parfois aussi de la pacotille) et de très nombreux articles religieux, à des prix souvent élevés. Ce qui nous amène à penser que quand on croit, on ne compte pas plus que quand on aime !
Temple hindou et synagogue
Depuis le Merlion en bord de mer, inutile de prendre un taxi pour se rendre à Waterloo Street, le marcheur ira bien plus vite qu’un véhicule compte tenu des embouteillages dans ce secteur de la ville.
N’allez pas imaginer qu’au cœur de ce quartier chinois, les autres croyances n’ont pas leur place. Tout au contraire, puisque s’y trouvent également le temple Sri Krishnan et même la synagogue Maghain Aboth, la plus ancienne de Singapour, bâtie par et pour la communauté juive de la ville en 1878.
Preuve qu’avec un peu de bonne volonté et de respect, les croyances peuvent se juxtaposer sans souci aucun, le temple hindou étant d’ailleurs littéralement collé au temple chinois...
Waterloo Street était plus longue initialement qu’elle ne l’est aujourd’hui car l’urbanisme a modifié très largement la cité et la construction du campus de la Singapore Management University (et de la station de métro du coin) a nécessité un petit coup de ciseau.
Une chose à savoir sur Waterloo Street : elle “affiche complet” tous les après-midis, c’est clair, mais les week-ends et les jours fériés, c’est pire encore. La foule y est d’une extravagante densité, se partageant entre un centre commercial (au nord), le Kwan Im Thong Hood Cho Temple et un nombre impressionnant de boutiques vendant aussi bien de l’artisanat chinois (de grande qualité, parfois aussi de la pacotille) et de très nombreux articles religieux, à des prix souvent élevés. Ce qui nous amène à penser que quand on croit, on ne compte pas plus que quand on aime !
Temple hindou et synagogue
Depuis le Merlion en bord de mer, inutile de prendre un taxi pour se rendre à Waterloo Street, le marcheur ira bien plus vite qu’un véhicule compte tenu des embouteillages dans ce secteur de la ville.
N’allez pas imaginer qu’au cœur de ce quartier chinois, les autres croyances n’ont pas leur place. Tout au contraire, puisque s’y trouvent également le temple Sri Krishnan et même la synagogue Maghain Aboth, la plus ancienne de Singapour, bâtie par et pour la communauté juive de la ville en 1878.
Preuve qu’avec un peu de bonne volonté et de respect, les croyances peuvent se juxtaposer sans souci aucun, le temple hindou étant d’ailleurs littéralement collé au temple chinois...
Le temple de la double chance
S’il est une chose à laquelle les Chinois de Singapour accordent le plus vif intérêt, c’est leur réussite économique et sociale ; à ce titre, au 178 de la Waterloo Street, le temple Kwan Im Thong Hood Cho est incontournable pour une double raison : sa fréquentation permet aux fidèles de mettre la chance de leur côté dans leurs entreprises s’ils prient avec ferveur Kuan Yin, mais aussi dans la foulée Avalokitesvara, la déesse de la miséricorde qui se trouve dans le temple contigüe, le Sri Krishnan.
Culte croisé, double assurance...
Cette double pratique religieuse, appelée “culte croisé”, permet ainsi aux Indiens comme aux Chinois de multiplier les chances de s’accorder les faveurs des cieux (on remarquera, à une autre échelle et peut-être plus discrètement, que ce culte croisé se retrouve à Tahiti aussi, puisque certains Chinois catholiques de l’île fréquentent à la fois l’église de leur paroisse et le temple de Kanti, sans que cela ne gêne qui que ce soit).
Ces deux temples hindou et chinois, généralement bondés à Singapour, recueillent également des fonds pour un certain nombre d’œuvres caritatives, en matière de santé et d’éducation.
Un petit chef d’œuvre
Le Kwan Im Thong Hood Cho est ancien puisqu’il a vu le jour en 1884 ; d’abord modeste construction, sa fréquentation et les dons recueillis ont permis en 1895 de lui donner son apparence actuelle, petit chef d’œuvre de la sculpture et du savoir-faire chinois en matière de décoration.
Ce temple a d’autant plus la réputation de porter chance que durant la Seconde Guerre mondiale, si de nombreux bâtiments aux alentours ont été détruits, le temple lui n’a pas souffert et a, du coup, servi d’hôpital pour soigner les blessés dus aux bombardements japonais.
Plusieurs personnages y sont adorés : d’abord Kuan Yin bien entendu, mais aussi Bodhidharma (le fondateur du bouddhisme zen) et Hua Tuo, saint patron chinois de la médecine, réputé pour ses pouvoirs de guérison. Sans omettre bien entendu un Bouddha Sakyamuni.
Affluence pour le Jour de l’An
La fréquentation du lieu ne cessant de s’intensifier, le temple a dû faire l’objet d’une profonde réorganisation en 1982. Depuis, l’encens n’est plus brûlé à l’intérieur même de l’édifice, mais à l’entrée, de manière à ce que la suie ne recouvre pas le plafond. Les touristes éviteront de se rendre dans ce lieu de culte le premier et le quinzième jour du Nouvel An Chinois car alors la foule, bien décidée à se donner toutes les chances pour entamer sous les meilleurs auspices la nouvelle année, se presse et bloque complètement la rue.
A la veille du Nouvel An, le temple ouvre d’ailleurs ses portes toute la journée et toute la nuit, ce qui est supposé fluidifier le passage des fidèles ; mais en réalité, les files d’attente sont interminables et il n’est pas question pour un touriste de ne pas les respecter pour aller prendre des photos…
“Mariage” avec l’hindouisme
Une autre activité liée à la fréquentation du temple est la divination : le site a la réputation d’être extrêmement pointu dans ses prédictions et à ce titre, il est réputé bien au-delà de la seule ville de Singapour.
Enfin, mentionnons cette anecdote pour illustrer le fait que l’hindouisme et la religion populaire chinoise sont étroitement imbriquées sur cet emplacement ; la petite histoire dit qu’à la fin des années 1980, un vendeur de riz au poulet de Hainan a offert une grande urne, estimée à mille dollars singapouriens, au temple voisin de Sri Krishnan, pour recueillir les bâtons d'encens des fidèles chinois.
Du coup, les prêtres du Sri Krishnan ont de leur côté installé une statue de Guanyin à l'intérieur de leur temple réservant ainsi une place pour que les fidèles chinois brûlent de l’encens.
Investi dans le caritatif
Concluons en précisant que l’administration du temple, qui recueille beaucoup de fonds de la part des fidèles, a su (et sait) les utiliser à bon escient : depuis 1997, un centre de dialyse rénale a été réalisé, une chaire d’informatique a été financée à l’université, un programme national de dépistage médical a été mis sur pied, des bourses d’études, quelle que soit la couleur de peau des étudiants, sont proposées, le temple s’investissant même dans la scène artistique de la cité-État. Bref un lieu de vie et de croyances qui mérite indubitablement le détour, dans le respect des personnes, toujours très nombreuses, qui s’y trouvent.
Culte croisé, double assurance...
Cette double pratique religieuse, appelée “culte croisé”, permet ainsi aux Indiens comme aux Chinois de multiplier les chances de s’accorder les faveurs des cieux (on remarquera, à une autre échelle et peut-être plus discrètement, que ce culte croisé se retrouve à Tahiti aussi, puisque certains Chinois catholiques de l’île fréquentent à la fois l’église de leur paroisse et le temple de Kanti, sans que cela ne gêne qui que ce soit).
Ces deux temples hindou et chinois, généralement bondés à Singapour, recueillent également des fonds pour un certain nombre d’œuvres caritatives, en matière de santé et d’éducation.
Un petit chef d’œuvre
Le Kwan Im Thong Hood Cho est ancien puisqu’il a vu le jour en 1884 ; d’abord modeste construction, sa fréquentation et les dons recueillis ont permis en 1895 de lui donner son apparence actuelle, petit chef d’œuvre de la sculpture et du savoir-faire chinois en matière de décoration.
Ce temple a d’autant plus la réputation de porter chance que durant la Seconde Guerre mondiale, si de nombreux bâtiments aux alentours ont été détruits, le temple lui n’a pas souffert et a, du coup, servi d’hôpital pour soigner les blessés dus aux bombardements japonais.
Plusieurs personnages y sont adorés : d’abord Kuan Yin bien entendu, mais aussi Bodhidharma (le fondateur du bouddhisme zen) et Hua Tuo, saint patron chinois de la médecine, réputé pour ses pouvoirs de guérison. Sans omettre bien entendu un Bouddha Sakyamuni.
Affluence pour le Jour de l’An
La fréquentation du lieu ne cessant de s’intensifier, le temple a dû faire l’objet d’une profonde réorganisation en 1982. Depuis, l’encens n’est plus brûlé à l’intérieur même de l’édifice, mais à l’entrée, de manière à ce que la suie ne recouvre pas le plafond. Les touristes éviteront de se rendre dans ce lieu de culte le premier et le quinzième jour du Nouvel An Chinois car alors la foule, bien décidée à se donner toutes les chances pour entamer sous les meilleurs auspices la nouvelle année, se presse et bloque complètement la rue.
A la veille du Nouvel An, le temple ouvre d’ailleurs ses portes toute la journée et toute la nuit, ce qui est supposé fluidifier le passage des fidèles ; mais en réalité, les files d’attente sont interminables et il n’est pas question pour un touriste de ne pas les respecter pour aller prendre des photos…
“Mariage” avec l’hindouisme
Une autre activité liée à la fréquentation du temple est la divination : le site a la réputation d’être extrêmement pointu dans ses prédictions et à ce titre, il est réputé bien au-delà de la seule ville de Singapour.
Enfin, mentionnons cette anecdote pour illustrer le fait que l’hindouisme et la religion populaire chinoise sont étroitement imbriquées sur cet emplacement ; la petite histoire dit qu’à la fin des années 1980, un vendeur de riz au poulet de Hainan a offert une grande urne, estimée à mille dollars singapouriens, au temple voisin de Sri Krishnan, pour recueillir les bâtons d'encens des fidèles chinois.
Du coup, les prêtres du Sri Krishnan ont de leur côté installé une statue de Guanyin à l'intérieur de leur temple réservant ainsi une place pour que les fidèles chinois brûlent de l’encens.
Investi dans le caritatif
Concluons en précisant que l’administration du temple, qui recueille beaucoup de fonds de la part des fidèles, a su (et sait) les utiliser à bon escient : depuis 1997, un centre de dialyse rénale a été réalisé, une chaire d’informatique a été financée à l’université, un programme national de dépistage médical a été mis sur pied, des bourses d’études, quelle que soit la couleur de peau des étudiants, sont proposées, le temple s’investissant même dans la scène artistique de la cité-État. Bref un lieu de vie et de croyances qui mérite indubitablement le détour, dans le respect des personnes, toujours très nombreuses, qui s’y trouvent.
Chinatown la touristique
Il peut sembler quelque peu bizarre de demander à visiter un Chinatown dans une ville chinoise, puisque toute la ville est par définition supposée être une sorte de Chinatown. En réalité, séparé par plus d’un kilomètre de Waterloo Street, le quartier de Chinatown correspond à ce que serait la vieille ville dans une cité classique.
A Chinatown, on est en effet loin, très loin du modernisme affiché sur le front de mer. La zone en question, malheureusement aujourd’hui très touristique, donc de moins en moins authentique, a en effet vu le jour il y a deux siècles, en 1821 pour être précis.
Un quartier redevenu “safe”
Oublions d’abord le passé relativement proche, où sur Keong Saik Road par exemple, on trouvait de tout dans les années soixante, des filles surtout, faut-il le préciser ? Aujourd’hui la prostitution a quasiment disparu de la cité au lion et Chinatown est redevenu un quartier certes très actif mais paisible.
Dès la fondation de la ville par Lord Raffles, les Britanniques firent appel à de la main-d’œuvre étrangère, à commencer par de la main-d’œuvre chinoise facile à transporter depuis Hong-Kong. Près du port où ils étaient employés, les Chinois de ce début du XIXe siècle se rassemblèrent mais le développement de la ville limita vite les possibilités d’extension de ce quartier coincé entre d’autres. Les Britanniques avaient en effet veiller à répartir les étrangers qu’ils faisaient venir en différents quartiers, des kampungs pour les Arabes, les Bugis, les Indiens, les Malais et les Chinois. Sans parler du quartier européen bien entendu, plus “select” comme l’étiquette l’exigeait.
Prendre soin de chaque ethnie
Le gouverneur Raffles ne se faisait pas d’illusions : pour mille et une bonnes raisons, ce sont les Chinois qui étaient appelés à devenir les plus nombreux, mais malgré tout, dans les plans de la ville, il fut prévu que chaque ethnie, autant que faire se pouvait, serait regroupée ; pour éviter tout risque d’incendie, les constructions devaient être faites en briques et en ciment (avec des toitures en tuiles). Pas question de laisser se développer des quartiers entiers en bois qu’une simple bougie transformerait en braiser géant.
Quand on relit les instructions de Raffles, on y découvre des mots comme sécurité, bien-être, confort, intérêt général, preuve que les “indigènes” comme on les appelait alors, quelle que soit leur ethnie, n’étaient pas considérés comme formant une sous-main-d’œuvre taillable et corvéable à merci. Ce que voulait Raffles, avant tout, c’était une ville harmonieuse, présentant à ses habitants des conditions de vie satisfaisantes, sachant que cette main-d’œuvre était appelée à faire souche sur place.
Plusieurs ethnies chinoises
Pour les Chinois, Raffles réserva le vaste terrain au sud-ouest de la rivière Singapour. Il fut réellement intransigeant pour que les bâtiments soient construits en dur et c’est en 1843 que commença réellement l’appropriation de ce que l’on appelait déjà Chinatown par les Chinois ; à cette date, ils purent en effet accéder à la propriété de lopins (en pleine propriété ou en location longue durée) sur lesquels ils avaient l’opportunité de lancer des affaires commerciales, d’ouvrir des magasins, bref de donner la pleine mesure de leur talent.
Même si, dans les décennies qui suivirent, nombre de Chinois s’installèrent dans d’autres quartiers de la cité, Chinatown demeura très surpeuplée jusque dans les années soixante où un plan d’urbanisation permit de les reloger dans d’autres secteurs.
Mais ne croyez pas que lorsqu’on parle de Chinatown, on parle d’un quartier homogène : les groupes ethniques originaires de Chine sont en effet pluriels, Cantonnais, Hokkien, Teochew, et si le dialecte cantonnais est aujourd’hui dominant, il n’en demeure pas moins que c’est d’une mosaïque chinoise qu’il convient de parler. Une mosaïque tolérante, puisque d’autres ethnies sont venues se greffer à ce quartier, qui compte certes de nombreux temples chinois, mais également des mosquées, des temples hindous tamouls, preuve que malgré la volonté britannique d’organiser la ville de manière très communautariste, les habitants, eux, surent parfaitement bien cohabiter.
A Chinatown, on est en effet loin, très loin du modernisme affiché sur le front de mer. La zone en question, malheureusement aujourd’hui très touristique, donc de moins en moins authentique, a en effet vu le jour il y a deux siècles, en 1821 pour être précis.
Un quartier redevenu “safe”
Oublions d’abord le passé relativement proche, où sur Keong Saik Road par exemple, on trouvait de tout dans les années soixante, des filles surtout, faut-il le préciser ? Aujourd’hui la prostitution a quasiment disparu de la cité au lion et Chinatown est redevenu un quartier certes très actif mais paisible.
Dès la fondation de la ville par Lord Raffles, les Britanniques firent appel à de la main-d’œuvre étrangère, à commencer par de la main-d’œuvre chinoise facile à transporter depuis Hong-Kong. Près du port où ils étaient employés, les Chinois de ce début du XIXe siècle se rassemblèrent mais le développement de la ville limita vite les possibilités d’extension de ce quartier coincé entre d’autres. Les Britanniques avaient en effet veiller à répartir les étrangers qu’ils faisaient venir en différents quartiers, des kampungs pour les Arabes, les Bugis, les Indiens, les Malais et les Chinois. Sans parler du quartier européen bien entendu, plus “select” comme l’étiquette l’exigeait.
Prendre soin de chaque ethnie
Le gouverneur Raffles ne se faisait pas d’illusions : pour mille et une bonnes raisons, ce sont les Chinois qui étaient appelés à devenir les plus nombreux, mais malgré tout, dans les plans de la ville, il fut prévu que chaque ethnie, autant que faire se pouvait, serait regroupée ; pour éviter tout risque d’incendie, les constructions devaient être faites en briques et en ciment (avec des toitures en tuiles). Pas question de laisser se développer des quartiers entiers en bois qu’une simple bougie transformerait en braiser géant.
Quand on relit les instructions de Raffles, on y découvre des mots comme sécurité, bien-être, confort, intérêt général, preuve que les “indigènes” comme on les appelait alors, quelle que soit leur ethnie, n’étaient pas considérés comme formant une sous-main-d’œuvre taillable et corvéable à merci. Ce que voulait Raffles, avant tout, c’était une ville harmonieuse, présentant à ses habitants des conditions de vie satisfaisantes, sachant que cette main-d’œuvre était appelée à faire souche sur place.
Plusieurs ethnies chinoises
Pour les Chinois, Raffles réserva le vaste terrain au sud-ouest de la rivière Singapour. Il fut réellement intransigeant pour que les bâtiments soient construits en dur et c’est en 1843 que commença réellement l’appropriation de ce que l’on appelait déjà Chinatown par les Chinois ; à cette date, ils purent en effet accéder à la propriété de lopins (en pleine propriété ou en location longue durée) sur lesquels ils avaient l’opportunité de lancer des affaires commerciales, d’ouvrir des magasins, bref de donner la pleine mesure de leur talent.
Même si, dans les décennies qui suivirent, nombre de Chinois s’installèrent dans d’autres quartiers de la cité, Chinatown demeura très surpeuplée jusque dans les années soixante où un plan d’urbanisation permit de les reloger dans d’autres secteurs.
Mais ne croyez pas que lorsqu’on parle de Chinatown, on parle d’un quartier homogène : les groupes ethniques originaires de Chine sont en effet pluriels, Cantonnais, Hokkien, Teochew, et si le dialecte cantonnais est aujourd’hui dominant, il n’en demeure pas moins que c’est d’une mosaïque chinoise qu’il convient de parler. Une mosaïque tolérante, puisque d’autres ethnies sont venues se greffer à ce quartier, qui compte certes de nombreux temples chinois, mais également des mosquées, des temples hindous tamouls, preuve que malgré la volonté britannique d’organiser la ville de manière très communautariste, les habitants, eux, surent parfaitement bien cohabiter.
1819 : Singapour à vendre 33 000 pesos
L’histoire offre parfois des anecdotes amusantes ; ainsi l’une des plus belles et des plus riches viles du monde, Singapour, a-t-elle été achetée en 1819 par les Britanniques pour la somme de 33 000 pesos espagnols, monnaie en vigueur dans la région du fait de la colonisation ibère des Philippines. Ce qui allait devenir le relais indispensable à l’expansion britannique en Asie, entre Inde et Chine, fut donc acquis pour une (grosse) bouchée de pain.
L’histoire de Singapour est ancienne, mais cette ville, qui est en quelque sorte la porte du Pacifique, n’était qu’un humble village de pêcheurs jusqu’à ce que sir Thomas Stamford Raffles ne s’entende avec le sultan de Johor, Hussein Shah, pour lui acheter sept-cent-dix-neuf kilomètres carrés en grande partie de jungle, mais pas n’importe quelle jungle puisqu’elle se trouvait à l’extrême sud du détroit de Malacca.
Une première offre en 1703
Déjà, en 1703, un sultan de Johor avait proposé à un autre Britannique, Alexander Hamilton, de lui offrir ce petit territoire. Le dit Hamilton (1688 ? - 1733 ?) ne vit pas plus loin que le bout de son nez et déclina l’offre. De ce Hamilton, on ne sait que peu de choses, puisque même ses dates de naissance et de décès sont entourées d’un certain flou. Marin d’origine écossaise, il navigua en Europe, au Moyen-Orient puis, très vite, il fut comme littéralement aspiré par l’Asie, tout à tour employé de l’Honourable East India Company (en 1688) puis impliqué dans une guerre locale avant d’opérer à son propre compte à partir d’un port indien, Surat, et enfin d’entrer comme capitaine de la Bombay Marine en 1717. Ses talents furent employés à traquer les pirates qui infestaient les rives du sous-continent indien. A ce titre, il écuma les eaux de l’actuelle Malaisie pour sécuriser la route maritime entre l’Inde et la Chine et c’est à cette occasion qu’il reçut l’offre de devenir le maître de l’île de Singapour, offre qu’il déclina (on lui doit un livre, A New Account of the East Indies).
Contrebalancer la VOC
Hamilton ayant raté son entrée dans les livres d’Histoire, un siècle plus tard, Raffles, lui, avait bien compris que face à la présence pesante des Néerlandais dont le port principal était Malacca, il fallait que la Grande-Bretagne dispose d’un relais dans cette région. Singapour était le site idéal, jusqu’alors fréquenté, outre par quelques pêcheurs, par les pirates de la région justement.
Pourquoi un tel “cadeau” de la part du sultan de Johor ? A l’évidence, des querelles au sein du sultanat (et avec certains de ses voisins) ainsi que la crainte de voir les Hollandais de la VOC (Compagnie néerlandaise des Indes orientales) étendre leur domination justifièrent aux yeux de Hussein Shah de se priver de cet emplacement en s’assurant que la rivalité entre les deux nations européennes lui permettrait de dormir tranquille.
La ville du lion
A l’époque, le site s’appelle déjà Singapour, alors que son premier nom connu était Tumasik au XIVe siècle ; la presqu’île était sous influence hindouiste et c’est un prince de Palembang, au sud de Sumatra, Parameswara qui envahit la région, assassina le chef de la petite cité et la rebaptisa “Singapura” qui signifie “ville du lion” en sanskrit. Ne cherchez pas de lions à Singapour, il n’y en a jamais eu, mais il est probable que Parameswara souhaitait imprimer à sa nouvelle résidence un nom à connotation plus guerrière ; peut-être avait-il vu un ou des tigres dans les forêts et depuis cette date, le lion est demeuré le symbole de la cité-État, avec toutefois une petite modification : le “lion” de Singapour est un Merlion, fauve à queue de poisson ou de sirène...
Quant à la région malaise, sous l’influence des commerçants arabes, elle opta pour l’Islam, abandonnant ainsi l’hindouisme.
L’histoire de Singapour est ancienne, mais cette ville, qui est en quelque sorte la porte du Pacifique, n’était qu’un humble village de pêcheurs jusqu’à ce que sir Thomas Stamford Raffles ne s’entende avec le sultan de Johor, Hussein Shah, pour lui acheter sept-cent-dix-neuf kilomètres carrés en grande partie de jungle, mais pas n’importe quelle jungle puisqu’elle se trouvait à l’extrême sud du détroit de Malacca.
Une première offre en 1703
Déjà, en 1703, un sultan de Johor avait proposé à un autre Britannique, Alexander Hamilton, de lui offrir ce petit territoire. Le dit Hamilton (1688 ? - 1733 ?) ne vit pas plus loin que le bout de son nez et déclina l’offre. De ce Hamilton, on ne sait que peu de choses, puisque même ses dates de naissance et de décès sont entourées d’un certain flou. Marin d’origine écossaise, il navigua en Europe, au Moyen-Orient puis, très vite, il fut comme littéralement aspiré par l’Asie, tout à tour employé de l’Honourable East India Company (en 1688) puis impliqué dans une guerre locale avant d’opérer à son propre compte à partir d’un port indien, Surat, et enfin d’entrer comme capitaine de la Bombay Marine en 1717. Ses talents furent employés à traquer les pirates qui infestaient les rives du sous-continent indien. A ce titre, il écuma les eaux de l’actuelle Malaisie pour sécuriser la route maritime entre l’Inde et la Chine et c’est à cette occasion qu’il reçut l’offre de devenir le maître de l’île de Singapour, offre qu’il déclina (on lui doit un livre, A New Account of the East Indies).
Contrebalancer la VOC
Hamilton ayant raté son entrée dans les livres d’Histoire, un siècle plus tard, Raffles, lui, avait bien compris que face à la présence pesante des Néerlandais dont le port principal était Malacca, il fallait que la Grande-Bretagne dispose d’un relais dans cette région. Singapour était le site idéal, jusqu’alors fréquenté, outre par quelques pêcheurs, par les pirates de la région justement.
Pourquoi un tel “cadeau” de la part du sultan de Johor ? A l’évidence, des querelles au sein du sultanat (et avec certains de ses voisins) ainsi que la crainte de voir les Hollandais de la VOC (Compagnie néerlandaise des Indes orientales) étendre leur domination justifièrent aux yeux de Hussein Shah de se priver de cet emplacement en s’assurant que la rivalité entre les deux nations européennes lui permettrait de dormir tranquille.
La ville du lion
A l’époque, le site s’appelle déjà Singapour, alors que son premier nom connu était Tumasik au XIVe siècle ; la presqu’île était sous influence hindouiste et c’est un prince de Palembang, au sud de Sumatra, Parameswara qui envahit la région, assassina le chef de la petite cité et la rebaptisa “Singapura” qui signifie “ville du lion” en sanskrit. Ne cherchez pas de lions à Singapour, il n’y en a jamais eu, mais il est probable que Parameswara souhaitait imprimer à sa nouvelle résidence un nom à connotation plus guerrière ; peut-être avait-il vu un ou des tigres dans les forêts et depuis cette date, le lion est demeuré le symbole de la cité-État, avec toutefois une petite modification : le “lion” de Singapour est un Merlion, fauve à queue de poisson ou de sirène...
Quant à la région malaise, sous l’influence des commerçants arabes, elle opta pour l’Islam, abandonnant ainsi l’hindouisme.
Raffles en quelques mots

Portait de George Francis Stamford Raffles qui eut l’idée de génie de fonder Singapour sur ce site ô combien stratégique en Asie du Sud-Est.
Né dans une famille de marins le 5 juillet 1781 (son père était capitaine du vaisseau Ann sur lequel son fils vit le jour lors d’une traversée, au large des côtes de la Jamaïque), Thomas Stanford Bingley Raffles commença sa vie professionnelle à quatorze ans non pas sur un navire mais comme simple employé de la Compagnie britannique des Indes orientales. A vingt-quatre ans, il est envoyé à Penang, en Malaisie. Son chemin est tracé, il est nommé en 1811 lieutenant-gouverneur de Java puis gouverneur à Bengkulu (Sumatra). A cette époque, les guerres napoléoniennes en Europe avaient monopolisé l’attention des Hollandais qui perdirent quelque peu le contrôle de cette région du monde.
Passionné de sciences naturelles et d’histoire, Raffles fait restaurer le magnifique temple de Borobudur à Java et dans la foulée, car il est aussi un humaniste, il abolit l’esclavage et le travail forcé à Java.
Singapour, son coup de génie
Revenu à Londres en 1815, il fonde la Zoological Society of London et participe à la création du premier zoo londonien.
Anobli en 1817, il repart en Asie en 1818, toujours pour le compte de la Compagnie britannique des Indes orientales et rachète alors Singapour au sultan de Johor. Il fonde officiellement la ville le 6 février 1919. Ce fut un coup de génie car il assura ainsi à la Grande-Bretagne un droit de regard sur tout le commerce entre l’Europe et les Indes d’une part et l’Extrême-Orient et la Chine d’autre part.
Sa carrière brillante prendra malheureusement fin tragiquement à Londres en 1826 : il est victime d’une brutale rupture d’anévrisme et décède le 5 juillet, âgé de seulement quarante-quatre ans.
A noter qu’en ce XIXe siècle pas toujours à la pointe des idées nouvelles en Angleterre, on refusa à sa dépouille le droit de reposer dans sa paroisse de Hendon, au prétexte qu’il était anti-esclavagiste (pour les pasteurs anglicans d’alors, un anti-esclavagiste ne pouvait donc pas être un bon chrétien !). Ce n’est qu’en 1920 que sa paroisse, une fois sa dépouille retrouvée, accepta qu’il repose dans le cimetière d’Hendon...
Passionné de sciences naturelles et d’histoire, Raffles fait restaurer le magnifique temple de Borobudur à Java et dans la foulée, car il est aussi un humaniste, il abolit l’esclavage et le travail forcé à Java.
Singapour, son coup de génie
Revenu à Londres en 1815, il fonde la Zoological Society of London et participe à la création du premier zoo londonien.
Anobli en 1817, il repart en Asie en 1818, toujours pour le compte de la Compagnie britannique des Indes orientales et rachète alors Singapour au sultan de Johor. Il fonde officiellement la ville le 6 février 1919. Ce fut un coup de génie car il assura ainsi à la Grande-Bretagne un droit de regard sur tout le commerce entre l’Europe et les Indes d’une part et l’Extrême-Orient et la Chine d’autre part.
Sa carrière brillante prendra malheureusement fin tragiquement à Londres en 1826 : il est victime d’une brutale rupture d’anévrisme et décède le 5 juillet, âgé de seulement quarante-quatre ans.
A noter qu’en ce XIXe siècle pas toujours à la pointe des idées nouvelles en Angleterre, on refusa à sa dépouille le droit de reposer dans sa paroisse de Hendon, au prétexte qu’il était anti-esclavagiste (pour les pasteurs anglicans d’alors, un anti-esclavagiste ne pouvait donc pas être un bon chrétien !). Ce n’est qu’en 1920 que sa paroisse, une fois sa dépouille retrouvée, accepta qu’il repose dans le cimetière d’Hendon...
Malacca, erreur néerlandaise
Quand on sillonne la longue presqu’île malaise, on comprend vite que stratégiquement, il n’y a pas photo entre l’intérêt présenté par Singapour et celui de la ville plus au nord de Malacca. Certes, ce port hollandais permettait aux navires de la VOC de circuler en relative sécurité dans cette région du monde si riche en épices, mais jamais les Hollandais n’accordèrent le moindre regard à Singapour, au bout de la presqu’île malaise, alors que pour Raffles, il fut évident de suite que c’était indubitablement la place à contrôler.
L’erreur des Hollandais fut donc géographique (le centre de gravité de la région se situant à Singapour) mais elle fut également purement technique : le port de Malacca n’est pas un port en eaux profondes, et dès lors, compte tenu des progrès permanents de la navigation et de l’augmentation de la taille (et du tirant d’eau) des navires de commerce, il était évident qu’à moyen ou long terme, Malacca allait montrer ses limites. Ce qui fut le cas à la fin du XIXe siècle, la ville aujourd’hui étant une belle cité touristique, plutôt endormie sur le plan économique (surtout si on la compare à Singapour).
L’erreur des Hollandais fut donc géographique (le centre de gravité de la région se situant à Singapour) mais elle fut également purement technique : le port de Malacca n’est pas un port en eaux profondes, et dès lors, compte tenu des progrès permanents de la navigation et de l’augmentation de la taille (et du tirant d’eau) des navires de commerce, il était évident qu’à moyen ou long terme, Malacca allait montrer ses limites. Ce qui fut le cas à la fin du XIXe siècle, la ville aujourd’hui étant une belle cité touristique, plutôt endormie sur le plan économique (surtout si on la compare à Singapour).