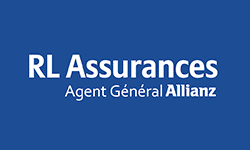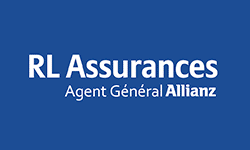Tahiti, le 21 mai 2021 - Lorsque l’on évoque les voyages de découvertes du capitaine James Cook, on n’oublie jamais d’associer au premier périple dans le Pacifique, à Tahiti notamment, le botaniste Joseph Banks, mais sans vraiment savoir ce que fut son odyssée et pourquoi il se trouvait à bord de l’Endeavour. Retour sur celui qui est entré dans l’Histoire comme l’homme qui décida de nourrir les esclaves des colonies britanniques avec les fruits du “uru”, cet arbre à pain devenu célèbre grâce à la Bounty.
Un point important avant de parcourir la dense et riche vie de Joseph Banks, l’homme qui voulut nourrir à peu de frais les esclaves de la couronne britannique dans la Caraïbe et bien au-delà. Si, effectivement, des plants d’arbres à pain finirent par être livrés à la Jamaïque en 1793 (mais aussi à St-Hélène et à St Vincent), il faut bien reconnaître que cette opération ambitieuse fut un fiasco : jamais en effet les esclaves noirs des possessions anglaises n’adoptèrent avec enthousiasme le fruit de l’arbre à pain et d’ailleurs de nos jours, il n’y a en réalité qu’à Porto Rico (et sur la petite île de Nevis) que le uru est devenu un ingrédient clé de la cuisine de tous les jours. Pour le reste des ex-colonies britanniques, les fruits du maiore (autre nom du uru) ne sont pas des grands classiques de l’art culinaire local. Rendons-leur toutefois cette justice que s’ils ne furent pas appréciés des esclaves, ils le sont tout de même aujourd’hui de plus en plus dans les cuisines locales.
Ceci étant écrit, il n’en demeure pas moins que l’arbre à pain est aujourd’hui présent dans environ quatre-vingt dix pays tropicaux, même si, encore une fois, il est loin d’avoir supplanté le manioc, le riz, la banane plantain ou même la patate douce dans la ceinture tropicale.
La traque de Vénus
Mais avant de revenir sur ce grand projet d’alimenter à moindre frais les esclaves, il convient de rappeler dans quel contexte le jeune Joseph Banks se trouvait à bord du navire du capitaine Cook, la HMS Endeavour, un ancien bateau charbonnier qui n’avait vraiment rien d’un fier lévrier des mers... A cette époque, début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’Amirauté avait plusieurs projets en tête, notamment celui de découvrir avant les autres nations la “Terra incognita”, le grand continent austral supposé contrebalancer et équilibrer le monde.
Les savants voulaient aussi connaître la distance de la Terre au soleil et pour cela, ils ne pouvaient le faire que lors du passage de la planète Vénus entre notre planète et le soleil. Or tous les calculs indiquaient que le meilleur point pour observer ce phénomène se situait à Tahiti, île découverte par Samuel Wallis en 1767, suivi en 1768 par le Français Louis-Antoine de Bougainville. Aussi fut-il décidé de conjuguer exploration et observation en envoyant une mission scientifique à l’autre bout du monde.
Banks, riche aristocrate
James Cook, d’extraction plutôt modeste, ancien de la marine marchande, était redevenu simple marin lorsqu’il avait décidé de rejoindre la Royale où il monta en grade à la force du poignet en travaillant dur pour obtenir son brevet lui permettant de commander un navire. C’est lui que la Royal Society choisit en réunissant un certain nombre de scientifiques dont Joseph Banks. Si Cook avait des humbles origines, Banks au contraire “roulait sur l’or”. Il était né le 13 février 1743 à Londres, son père étant membre de la Chambre des communes. Banks était donc un aristocrate, sorti du Eton College et de l’université d’Oxford. Passionné par la botanique, il fut désespéré en constatant qu’il n’y a pas de chaire de botaniste dans cette université. Qu’à cela ne tienne, il se paya un professeur qu’il fit venir à grand frais de Cambridge.
A dix-huit ans, il perdit son père qui lui laissa, en lot de consolation, une énorme fortune et quatre domaines agricoles rapportant gros : on parle de six mille livres par an, somme considérable pour l’époque. Sorti de l’université sans diplôme, il géra ses domaines mais se consacra de plus en plus à sa passion, la botanique, multipliant les rencontres avec des sommités anglaises et étrangères : Philip Miller (GB) Daniel Solander (Suède), Carl von Linné (Suède), Bernard de Jussieu (France)...
Argent et entregent...
Une expédition à Terre-Neuve et au Labrador lui permit de se familiariser avec la collecte et le classement d’échantillons ; il travailla à cette occasion avec un illustrateur que nous retrouverons plus tard, Sydney Parkinson ; une fois de retour à Londres, Daniel Solander l’aida considérablement à mettre à jour ses échantillons. L’expérience fut concluante, Banks avait dès lors très envie de poursuivre dans cette voie, celle de l’exploration de nouvelles terres et d’ailleurs, à vingt-trois ans seulement, il fut admis au sein de la Royal Society.
Il n’avait certes rien publié du tout, il n’avait pas de diplôme, mais il avait de l’argent, de l’entregent et il savait ce qu’il voulait. D’où cette entrée remarquée au sein de la Royal Society qui le plaça en première ligne pour être informé de tous les projets d’expédition ; c’est ainsi qu’il apprit que James Cook s’était vu confier par la Royal Society et la Royal Navy une exploration du vaste Pacifique. L’occasion était trop belle, Banks s’invita dans le projet avec ses moyens financiers et ses relations ; il fut immédiatement accepté et partit donc avec Cook, dans des conditions bien meilleures que celle du capitaine.
A bord en grand seigneur
James Cook avait certes sa cabine, mais Banks n’embarqua pas seul : avec lui, payés par lui, il imposa huit passagers et tout leur équipement. Le naturaliste embaucha deux autres confrères, Daniel Solander et H.P. Spöring, deux peintres et illustrateurs, Sydney Parkinson et Alexander Buchan, deux métayers qui étaient chargés du travail à terre lorsque Banks herborisait (ce sont eux qui se salissaient les mains...) et enfin, cerise sur le gâteau, deux domestiques noirs pour veiller à son bien-être. A côté de ce déploiement de forces, les scientifiques de la mission officielle (le transit de Vénus) faisaient piètre figure : un astronome (William Green) et son aide...
La petite histoire ne s’étend pas sur ce qu’un tel aréopage inspira à James Cook lui-même, mais le fait est que Banks arriva à bord de l’Endeavour en grand seigneur. Quatre-vingt quatorze personnes étaient entassées dans le navire (trente-cinq mètres de long sur neuf de large) et sur onze scientifiques, neuf étaient du clan Banks, à commencer par lui.
Deux morts en Terre de Feu
L’Endeavour leva ses ancres à Plymouth au mois d’août 1768 et parvint à Madère le 12 septembre 1768. En moins d’une semaine, Banks et Solander récoltèrent des centaines de spécimens, plantes et poissons notamment. A Rio de Janeiro, le vice-roi portugais n’était pas d’humeur. Il n’aimait pas les Anglais et ne permit pas à Banks d’herboriser, celui-ci quittant l’escale en parlant, à propos des Portugais, de “gentilshommes analphabètes et grossiers”.
Aux îles Falkland, l’ambiance fut plus détendue et la richesse de la flore, mais surtout de la faune, permit de recueillir de superbes échantillons. En Terre de Feu, premier drame sur lequel Banks ne s’étendra pas : venu explorer un coin sauvage de montagne le 16 janvier (plein été austral), Banks, parti par beau temps, fut surpris par une tempête de neige. Une cabane fut montée en toute hâte, Banks et les scientifiques s’y abritèrent, mais les deux serviteurs noirs n’avaient pas les mêmes privilèges et furent retrouvés morts de froid au petit matin. Ce qui n’empêcha pas Banks de continuer à herboriser avec un moral au beau fixe comme en témoignent ses écrits, les Fuégiens accueillants ne lui faisant aucune difficulté. Le cap Horn franchi, commença une longue navigation de quatre mille milles nautiques avant l’arrivée à Tahiti le 13 avril 1769, terre alors baptisée par Wallis “île du roi Georges”.
Belles nuits avec des Tahitiennes
Les premiers contacts furent amicaux, mais on nota qu’alors, ce furent Cook et Banks, jamais Cook seul, qui établirent des relations avec les Tahitiens, Banks se chargeant des cadeaux et paraissant être le diplomate en chef de l’escale : très habile, c’est lui qui négocia avec les arii dès que surgissait un problème, notamment pour récupérer des objets volés par les indigènes.
Cook, nettement plus rigide, n’avait pas ce sens de la palabre et de la discussion et les interventions multiples de Banks évitèrent sans doute de nombreux dérapages et tout autant de violence.
Le jeune Joseph était d’autant plus à l’aise au milieu des Tahitiens qu’il aimait par-dessus tout passer ses nuits à terre, “pour dormir seul dans le bois”. En réalité, c’est avec des Tahitiennes que Banks passa ses nuits, faisant en sorte d’être par ailleurs fort bien en cour avec la reine Oborea et sa jeune servante Otheothea “aux yeux de feu” s’il faut l’en croire. Intégré à la vie polynésienne, Banks en oublia presque ses collections (Solander faisait le travail !), se passionnant beaucoup plus pour l’ethnographie et les contacts humains ; il s’initia même au reo Tahiti. En trois mois, Banks avait percé bien des mystères de cette société insulaire dans laquelle il évoluait avec une grande aisance, Cook et Solander, avec l’astronome Green, veillant de leur côté à la réussite de la mission, à savoir avant tout l’observation du transit de la planète Vénus.
Cannibalisme et têtes momifiées
Comme l’écrivit Banks lui-même, “après un séjour de trois mois, nous quittâmes nos insulaires bien aimés avec beaucoup de regrets”. 13 avril 1769-13 juillet 1769 : après trois mois de grandes vacances pour Banks, il fallut bien reprendre la route, cap au sud jusqu’en Nouvelle-Zélande. Si Banks ne fit pas grand chose lors de son trimestre tahitien, on doit lui reconnaître toutefois qu’il mena une réflexion sur le fruit de l’arbre à pain, devant à ses yeux permettre de nourrir en zone tropicale les esclaves des colonies britanniques ; par ailleurs, il permit au Tahitien Tupaia d’embarquer à bord de l’Endeavour pour servir de guide à James Cook.
Autant Tahiti fut propice à de nombreux échanges avec les insulaires, autant Banks resta sur sa faim quant aux contacts avec les Maoris, systématiquement hostiles ; pas facile d’herboriser à terre pour le naturaliste anglais et son ami Solander, encore moins facile de parvenir à étudier les mœurs de ces populations (et plus encore, impossible d’aller batifoler à terre avec de jolies Maories...).
Malgré tout, Cook comme Banks surent rester dans leur pré-carré et ne portèrent pas de jugements définitifs sur les pratiques qu’ils découvrirent : cannibalisme, têtes d’ennemis décapitées, tatouées et momifiées, haka guerriers... Tout démontrait que les Maoris avaient érigé la violence en mode de gouvernance, mais les Britanniques ne tombèrent pas dans le piège du rejet systématique de cette population...
Le plus curieux des animaux...
L’exploration des deux grandes îles kiwies prit du temps : arrivé le 8 octobre 1769, Cook ne quitta la “terre du long nuage blanc” que le 31 mars 1770, après, il est vrai, avoir pu cartographier avec une grande précision pour l’époque ces régions peu connues. Deux semaines après avoir quitté les rives néo-zélandaises, Banks abordait les côtes de la Nouvelle-Hollande (actuelle Australie) ; le site retenu pour aller à terre fut baptisé Botany Bay par Cook qui constata avec satisfaction et même étonnement que Solander et Banks y effectuèrent de très nombreuses récoltes d’échantillons, souvent de plantes parfaitement inconnues en Occident.
Comme en Nouvelle-Zélande, les naturels, plus tard baptisés Aborigènes, évitèrent les contacts ; sans vêtements, sans ornements, disposant d’un armement réduit, ils n’étaient pas à proprement parler dangereux, mais en tous les cas peu désireux de faire connaissance avec leurs visiteurs. Plantes, mais aussi insectes (papillons notamment), oiseaux, poissons, la moisson des naturalistes fut impressionnante avec pour point d’orgue la découverte du plus curieux des animaux, le kangourou. Le 14 juillet, un spécimen fut tiré au fusil et finit en ragout le soir même, fournissant ainsi une viande qualifiée d’excellente.
Les pièges de la Grande Barrière
Si la moisson des naturalistes était spectaculaire, les travaux à conduire pour remettre l’Endeavour en état de revenir en Angleterre ne permirent guère à l’équipage de folâtrer alentour. Du 28 avril 1770 au mois d’août 1770, ce ne fut qu’un vaste chantier ; l’Endeavour, après avoir quitté Botany Bay n’en avait pas fini avec l’Australie puisqu’il lui fallait à tout prix sortir du dédale de la Grande Barrière de corail, ce qui ne se fit pas sans mal puisque le 11 juin 1770, le navire toucha un récif ; il fallut tout le sang-froid des officiers pour amener le bateau à la côte (vers l’actuelle ville de Queenstown) où les charpentiers de marine reprirent du service pour remettre la coque en état ; une opération qui leur prit sept longues semaines avant de pouvoir retrouver les eaux libres de l’océan Pacifique.
Seuls Banks et Solander trouvèrent matière à se réjouir de l’incident, puisque durant tout ce laps de temps, dans une région très différente de Botany Bay, ils purent reprendre leurs travaux et leur collecte d’échantillons tout beaux tout nouveaux (c’est lors de cette escale forcée qu’ils découvrirent les premiers kangourous). Quittant enfin l’Australie au mois d’août 1770, l’Endeavour parvint au prix de grandes difficultés à se sortir des pièges de la Grande Barrière pour parvenir à se glisser au sud de la Nouvelle-Guinée, avant de pouvoir faire escale en terre hollandaise, à Batavia (aujourd’hui Djakarta).
Hécatombe à Batavia
La Compagnie hollandaise des Indes orientales disposait à Batavia de son principal comptoir, mais malheureusement, le climat était malsain et les fièvres inévitables : Cook, Solander, Banks et tant d’autres furent affectés gravement par ces fièvres auxquelles s’ajoutaient des dysenteries qui se révélèrent souvent mortelles. Banks avait déjà vu ses deux serviteurs noirs mourir en Terre de Feu. A Batavia, ce fut une hécatombe pour tout l’équipage du charbonnier britannique, pour les marins comme pour les officiers et les scientifiques ; ainsi Banks perdit la moitié de la petite troupe qu’il avait embarquée. Le chirurgien Monkhouse, l’astronome Green, qui avait fait du si bon travail à Tahiti, le naturaliste Spöring, le peintre Buchan, l’illustrateur Sydney Parkinson trouvèrent ici la mort, Cook enregistrant un total de trente-huit décès à la suite de cette escale qui dura du 9 octobre 1770 au 25 décembre 1770.
Le jeune Tahitien Tupaia perdit lui aussi la vie (le 11 décembre 1770), victime de ces fièvres inconnues en Polynésie. Certains malades moribonds purent quitter Batavia encore en vie, mais décédèrent au large, quelques jours après leur sortie de l’enfer. Inutile de préciser qu’à Batavia, Banks comme Solander n’eurent guère de temps pour herboriser ; il leur fallut se soigner et survivre ce qui ne leur permit guère de travailler comme ils avaient pu le faire précédemment.
Aucune publication de Banks à son retour !
Le 13 juillet 1771, Joseph Banks retrouvait le confort de la ville de Londres, mais malgré un accueil triomphal, il restait à la fois épuisé et abattu par l’ampleur des décès ayant frappé son équipe scientifique. Evidemment, un travail considérable commençait aussi, puisqu’il fallait rassembler ces collections, veiller à leur conservation, à leur classement et à la publication des découvertes ainsi faites et Banks décida de confier le travail à l’infatigable Solander, l’ami sûr.
Parkinson avait laissé 743 aquarelles ; dix-huit graveurs furent embauchés pour les reproduire sur plaques de cuivre, mais finalement, rien ne fut publié du vivant de Banks qui légua ses trésors au British Museum. L’intégralité de ce qui devait s’appeler le “Florilège de Banks” ne fut finalement imprimé qu’à la fin du XXe siècle.
Après son exceptionnel tour de monde, les observateurs s’étonnèrent de constater qu’en réalité, Joseph Banks fut incapable de publier quoi que ce soit ; le naturaliste ne put embarquer pour le second voyage de Cook ; il avait des exigences jugées exorbitantes par l’Amirauté qui le remercia peu avant le départ de Cook (il fut remplacé par le naturaliste allemand Johann Reinhold Forster).
Président de la Royal Society
Joseph Banks, élevé au rang de héros national devint président de la Royal Society en 1778, après avoir mené quelques autres petites expéditions en Grande-Bretagne ; des broutilles par rapport à son tour du monde. La Royal Society devint son nouveau champ de bataille puisqu’il en demeura le président pendant quarante et un ans, jusqu’à sa mort en 1820, à 77 ans. En 1778, il n’avait alors que trente-cinq ans.
Son prédécesseur Newton, avait fait des mathématiques la discipline reine de la Royal Society. Avec Banks, ce fut bien évidemment la botanique et plus généralement les sciences naturelles qui devinrent prépondérantes, Banks prenant sous son aile les jardins botaniques royaux de Kew. Ceux-ci demeurent aujourd’hui encore la référence mondiale en matière de botanique.
Sans plus se déplacer lui-même, mais en organisateur méticuleux, le naturaliste multiplia les campagnes de récolte de plantes nouvelles, cultivées sous serre lorsqu’elles venaient de régions tropicales et à partir des jardins de Kew, ce sont des centaines de plantes ornementales ou utiles qui furent d’abord récoltées, puis étudiées et enfin, en fonction de leur intérêt, dispatchées dans le monde entier.
C’est évidemment dans ce cadre de transfert de plantes utiles que Banks, se souvenant de l’utilisation de l’arbre à pain à Tahiti, décida d’introduire celui-ci d’abord dans la Caraïbe pour nourrir à bon compte les esclaves noirs des plantations. George III, le souverain, fut enchanté par l’idée et ce fut la mise sur pied et le départ de la célèbre HMS Bounty commandée par l’inflexible capitaine Bligh. Si la mutinerie de 1789 réduisit la mission à néant, Bligh revint en 1792 et cette fois-ci réussit ; mais on le sait, ce fruit ne rencontra pas la faveur des esclaves...
Un point important avant de parcourir la dense et riche vie de Joseph Banks, l’homme qui voulut nourrir à peu de frais les esclaves de la couronne britannique dans la Caraïbe et bien au-delà. Si, effectivement, des plants d’arbres à pain finirent par être livrés à la Jamaïque en 1793 (mais aussi à St-Hélène et à St Vincent), il faut bien reconnaître que cette opération ambitieuse fut un fiasco : jamais en effet les esclaves noirs des possessions anglaises n’adoptèrent avec enthousiasme le fruit de l’arbre à pain et d’ailleurs de nos jours, il n’y a en réalité qu’à Porto Rico (et sur la petite île de Nevis) que le uru est devenu un ingrédient clé de la cuisine de tous les jours. Pour le reste des ex-colonies britanniques, les fruits du maiore (autre nom du uru) ne sont pas des grands classiques de l’art culinaire local. Rendons-leur toutefois cette justice que s’ils ne furent pas appréciés des esclaves, ils le sont tout de même aujourd’hui de plus en plus dans les cuisines locales.
Ceci étant écrit, il n’en demeure pas moins que l’arbre à pain est aujourd’hui présent dans environ quatre-vingt dix pays tropicaux, même si, encore une fois, il est loin d’avoir supplanté le manioc, le riz, la banane plantain ou même la patate douce dans la ceinture tropicale.
La traque de Vénus
Mais avant de revenir sur ce grand projet d’alimenter à moindre frais les esclaves, il convient de rappeler dans quel contexte le jeune Joseph Banks se trouvait à bord du navire du capitaine Cook, la HMS Endeavour, un ancien bateau charbonnier qui n’avait vraiment rien d’un fier lévrier des mers... A cette époque, début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’Amirauté avait plusieurs projets en tête, notamment celui de découvrir avant les autres nations la “Terra incognita”, le grand continent austral supposé contrebalancer et équilibrer le monde.
Les savants voulaient aussi connaître la distance de la Terre au soleil et pour cela, ils ne pouvaient le faire que lors du passage de la planète Vénus entre notre planète et le soleil. Or tous les calculs indiquaient que le meilleur point pour observer ce phénomène se situait à Tahiti, île découverte par Samuel Wallis en 1767, suivi en 1768 par le Français Louis-Antoine de Bougainville. Aussi fut-il décidé de conjuguer exploration et observation en envoyant une mission scientifique à l’autre bout du monde.
Banks, riche aristocrate
James Cook, d’extraction plutôt modeste, ancien de la marine marchande, était redevenu simple marin lorsqu’il avait décidé de rejoindre la Royale où il monta en grade à la force du poignet en travaillant dur pour obtenir son brevet lui permettant de commander un navire. C’est lui que la Royal Society choisit en réunissant un certain nombre de scientifiques dont Joseph Banks. Si Cook avait des humbles origines, Banks au contraire “roulait sur l’or”. Il était né le 13 février 1743 à Londres, son père étant membre de la Chambre des communes. Banks était donc un aristocrate, sorti du Eton College et de l’université d’Oxford. Passionné par la botanique, il fut désespéré en constatant qu’il n’y a pas de chaire de botaniste dans cette université. Qu’à cela ne tienne, il se paya un professeur qu’il fit venir à grand frais de Cambridge.
A dix-huit ans, il perdit son père qui lui laissa, en lot de consolation, une énorme fortune et quatre domaines agricoles rapportant gros : on parle de six mille livres par an, somme considérable pour l’époque. Sorti de l’université sans diplôme, il géra ses domaines mais se consacra de plus en plus à sa passion, la botanique, multipliant les rencontres avec des sommités anglaises et étrangères : Philip Miller (GB) Daniel Solander (Suède), Carl von Linné (Suède), Bernard de Jussieu (France)...
Argent et entregent...
Une expédition à Terre-Neuve et au Labrador lui permit de se familiariser avec la collecte et le classement d’échantillons ; il travailla à cette occasion avec un illustrateur que nous retrouverons plus tard, Sydney Parkinson ; une fois de retour à Londres, Daniel Solander l’aida considérablement à mettre à jour ses échantillons. L’expérience fut concluante, Banks avait dès lors très envie de poursuivre dans cette voie, celle de l’exploration de nouvelles terres et d’ailleurs, à vingt-trois ans seulement, il fut admis au sein de la Royal Society.
Il n’avait certes rien publié du tout, il n’avait pas de diplôme, mais il avait de l’argent, de l’entregent et il savait ce qu’il voulait. D’où cette entrée remarquée au sein de la Royal Society qui le plaça en première ligne pour être informé de tous les projets d’expédition ; c’est ainsi qu’il apprit que James Cook s’était vu confier par la Royal Society et la Royal Navy une exploration du vaste Pacifique. L’occasion était trop belle, Banks s’invita dans le projet avec ses moyens financiers et ses relations ; il fut immédiatement accepté et partit donc avec Cook, dans des conditions bien meilleures que celle du capitaine.
A bord en grand seigneur
James Cook avait certes sa cabine, mais Banks n’embarqua pas seul : avec lui, payés par lui, il imposa huit passagers et tout leur équipement. Le naturaliste embaucha deux autres confrères, Daniel Solander et H.P. Spöring, deux peintres et illustrateurs, Sydney Parkinson et Alexander Buchan, deux métayers qui étaient chargés du travail à terre lorsque Banks herborisait (ce sont eux qui se salissaient les mains...) et enfin, cerise sur le gâteau, deux domestiques noirs pour veiller à son bien-être. A côté de ce déploiement de forces, les scientifiques de la mission officielle (le transit de Vénus) faisaient piètre figure : un astronome (William Green) et son aide...
La petite histoire ne s’étend pas sur ce qu’un tel aréopage inspira à James Cook lui-même, mais le fait est que Banks arriva à bord de l’Endeavour en grand seigneur. Quatre-vingt quatorze personnes étaient entassées dans le navire (trente-cinq mètres de long sur neuf de large) et sur onze scientifiques, neuf étaient du clan Banks, à commencer par lui.
Deux morts en Terre de Feu
L’Endeavour leva ses ancres à Plymouth au mois d’août 1768 et parvint à Madère le 12 septembre 1768. En moins d’une semaine, Banks et Solander récoltèrent des centaines de spécimens, plantes et poissons notamment. A Rio de Janeiro, le vice-roi portugais n’était pas d’humeur. Il n’aimait pas les Anglais et ne permit pas à Banks d’herboriser, celui-ci quittant l’escale en parlant, à propos des Portugais, de “gentilshommes analphabètes et grossiers”.
Aux îles Falkland, l’ambiance fut plus détendue et la richesse de la flore, mais surtout de la faune, permit de recueillir de superbes échantillons. En Terre de Feu, premier drame sur lequel Banks ne s’étendra pas : venu explorer un coin sauvage de montagne le 16 janvier (plein été austral), Banks, parti par beau temps, fut surpris par une tempête de neige. Une cabane fut montée en toute hâte, Banks et les scientifiques s’y abritèrent, mais les deux serviteurs noirs n’avaient pas les mêmes privilèges et furent retrouvés morts de froid au petit matin. Ce qui n’empêcha pas Banks de continuer à herboriser avec un moral au beau fixe comme en témoignent ses écrits, les Fuégiens accueillants ne lui faisant aucune difficulté. Le cap Horn franchi, commença une longue navigation de quatre mille milles nautiques avant l’arrivée à Tahiti le 13 avril 1769, terre alors baptisée par Wallis “île du roi Georges”.
Belles nuits avec des Tahitiennes
Les premiers contacts furent amicaux, mais on nota qu’alors, ce furent Cook et Banks, jamais Cook seul, qui établirent des relations avec les Tahitiens, Banks se chargeant des cadeaux et paraissant être le diplomate en chef de l’escale : très habile, c’est lui qui négocia avec les arii dès que surgissait un problème, notamment pour récupérer des objets volés par les indigènes.
Cook, nettement plus rigide, n’avait pas ce sens de la palabre et de la discussion et les interventions multiples de Banks évitèrent sans doute de nombreux dérapages et tout autant de violence.
Le jeune Joseph était d’autant plus à l’aise au milieu des Tahitiens qu’il aimait par-dessus tout passer ses nuits à terre, “pour dormir seul dans le bois”. En réalité, c’est avec des Tahitiennes que Banks passa ses nuits, faisant en sorte d’être par ailleurs fort bien en cour avec la reine Oborea et sa jeune servante Otheothea “aux yeux de feu” s’il faut l’en croire. Intégré à la vie polynésienne, Banks en oublia presque ses collections (Solander faisait le travail !), se passionnant beaucoup plus pour l’ethnographie et les contacts humains ; il s’initia même au reo Tahiti. En trois mois, Banks avait percé bien des mystères de cette société insulaire dans laquelle il évoluait avec une grande aisance, Cook et Solander, avec l’astronome Green, veillant de leur côté à la réussite de la mission, à savoir avant tout l’observation du transit de la planète Vénus.
Cannibalisme et têtes momifiées
Comme l’écrivit Banks lui-même, “après un séjour de trois mois, nous quittâmes nos insulaires bien aimés avec beaucoup de regrets”. 13 avril 1769-13 juillet 1769 : après trois mois de grandes vacances pour Banks, il fallut bien reprendre la route, cap au sud jusqu’en Nouvelle-Zélande. Si Banks ne fit pas grand chose lors de son trimestre tahitien, on doit lui reconnaître toutefois qu’il mena une réflexion sur le fruit de l’arbre à pain, devant à ses yeux permettre de nourrir en zone tropicale les esclaves des colonies britanniques ; par ailleurs, il permit au Tahitien Tupaia d’embarquer à bord de l’Endeavour pour servir de guide à James Cook.
Autant Tahiti fut propice à de nombreux échanges avec les insulaires, autant Banks resta sur sa faim quant aux contacts avec les Maoris, systématiquement hostiles ; pas facile d’herboriser à terre pour le naturaliste anglais et son ami Solander, encore moins facile de parvenir à étudier les mœurs de ces populations (et plus encore, impossible d’aller batifoler à terre avec de jolies Maories...).
Malgré tout, Cook comme Banks surent rester dans leur pré-carré et ne portèrent pas de jugements définitifs sur les pratiques qu’ils découvrirent : cannibalisme, têtes d’ennemis décapitées, tatouées et momifiées, haka guerriers... Tout démontrait que les Maoris avaient érigé la violence en mode de gouvernance, mais les Britanniques ne tombèrent pas dans le piège du rejet systématique de cette population...
Le plus curieux des animaux...
L’exploration des deux grandes îles kiwies prit du temps : arrivé le 8 octobre 1769, Cook ne quitta la “terre du long nuage blanc” que le 31 mars 1770, après, il est vrai, avoir pu cartographier avec une grande précision pour l’époque ces régions peu connues. Deux semaines après avoir quitté les rives néo-zélandaises, Banks abordait les côtes de la Nouvelle-Hollande (actuelle Australie) ; le site retenu pour aller à terre fut baptisé Botany Bay par Cook qui constata avec satisfaction et même étonnement que Solander et Banks y effectuèrent de très nombreuses récoltes d’échantillons, souvent de plantes parfaitement inconnues en Occident.
Comme en Nouvelle-Zélande, les naturels, plus tard baptisés Aborigènes, évitèrent les contacts ; sans vêtements, sans ornements, disposant d’un armement réduit, ils n’étaient pas à proprement parler dangereux, mais en tous les cas peu désireux de faire connaissance avec leurs visiteurs. Plantes, mais aussi insectes (papillons notamment), oiseaux, poissons, la moisson des naturalistes fut impressionnante avec pour point d’orgue la découverte du plus curieux des animaux, le kangourou. Le 14 juillet, un spécimen fut tiré au fusil et finit en ragout le soir même, fournissant ainsi une viande qualifiée d’excellente.
Les pièges de la Grande Barrière
Si la moisson des naturalistes était spectaculaire, les travaux à conduire pour remettre l’Endeavour en état de revenir en Angleterre ne permirent guère à l’équipage de folâtrer alentour. Du 28 avril 1770 au mois d’août 1770, ce ne fut qu’un vaste chantier ; l’Endeavour, après avoir quitté Botany Bay n’en avait pas fini avec l’Australie puisqu’il lui fallait à tout prix sortir du dédale de la Grande Barrière de corail, ce qui ne se fit pas sans mal puisque le 11 juin 1770, le navire toucha un récif ; il fallut tout le sang-froid des officiers pour amener le bateau à la côte (vers l’actuelle ville de Queenstown) où les charpentiers de marine reprirent du service pour remettre la coque en état ; une opération qui leur prit sept longues semaines avant de pouvoir retrouver les eaux libres de l’océan Pacifique.
Seuls Banks et Solander trouvèrent matière à se réjouir de l’incident, puisque durant tout ce laps de temps, dans une région très différente de Botany Bay, ils purent reprendre leurs travaux et leur collecte d’échantillons tout beaux tout nouveaux (c’est lors de cette escale forcée qu’ils découvrirent les premiers kangourous). Quittant enfin l’Australie au mois d’août 1770, l’Endeavour parvint au prix de grandes difficultés à se sortir des pièges de la Grande Barrière pour parvenir à se glisser au sud de la Nouvelle-Guinée, avant de pouvoir faire escale en terre hollandaise, à Batavia (aujourd’hui Djakarta).
Hécatombe à Batavia
La Compagnie hollandaise des Indes orientales disposait à Batavia de son principal comptoir, mais malheureusement, le climat était malsain et les fièvres inévitables : Cook, Solander, Banks et tant d’autres furent affectés gravement par ces fièvres auxquelles s’ajoutaient des dysenteries qui se révélèrent souvent mortelles. Banks avait déjà vu ses deux serviteurs noirs mourir en Terre de Feu. A Batavia, ce fut une hécatombe pour tout l’équipage du charbonnier britannique, pour les marins comme pour les officiers et les scientifiques ; ainsi Banks perdit la moitié de la petite troupe qu’il avait embarquée. Le chirurgien Monkhouse, l’astronome Green, qui avait fait du si bon travail à Tahiti, le naturaliste Spöring, le peintre Buchan, l’illustrateur Sydney Parkinson trouvèrent ici la mort, Cook enregistrant un total de trente-huit décès à la suite de cette escale qui dura du 9 octobre 1770 au 25 décembre 1770.
Le jeune Tahitien Tupaia perdit lui aussi la vie (le 11 décembre 1770), victime de ces fièvres inconnues en Polynésie. Certains malades moribonds purent quitter Batavia encore en vie, mais décédèrent au large, quelques jours après leur sortie de l’enfer. Inutile de préciser qu’à Batavia, Banks comme Solander n’eurent guère de temps pour herboriser ; il leur fallut se soigner et survivre ce qui ne leur permit guère de travailler comme ils avaient pu le faire précédemment.
Aucune publication de Banks à son retour !
Le 13 juillet 1771, Joseph Banks retrouvait le confort de la ville de Londres, mais malgré un accueil triomphal, il restait à la fois épuisé et abattu par l’ampleur des décès ayant frappé son équipe scientifique. Evidemment, un travail considérable commençait aussi, puisqu’il fallait rassembler ces collections, veiller à leur conservation, à leur classement et à la publication des découvertes ainsi faites et Banks décida de confier le travail à l’infatigable Solander, l’ami sûr.
Parkinson avait laissé 743 aquarelles ; dix-huit graveurs furent embauchés pour les reproduire sur plaques de cuivre, mais finalement, rien ne fut publié du vivant de Banks qui légua ses trésors au British Museum. L’intégralité de ce qui devait s’appeler le “Florilège de Banks” ne fut finalement imprimé qu’à la fin du XXe siècle.
Après son exceptionnel tour de monde, les observateurs s’étonnèrent de constater qu’en réalité, Joseph Banks fut incapable de publier quoi que ce soit ; le naturaliste ne put embarquer pour le second voyage de Cook ; il avait des exigences jugées exorbitantes par l’Amirauté qui le remercia peu avant le départ de Cook (il fut remplacé par le naturaliste allemand Johann Reinhold Forster).
Président de la Royal Society
Joseph Banks, élevé au rang de héros national devint président de la Royal Society en 1778, après avoir mené quelques autres petites expéditions en Grande-Bretagne ; des broutilles par rapport à son tour du monde. La Royal Society devint son nouveau champ de bataille puisqu’il en demeura le président pendant quarante et un ans, jusqu’à sa mort en 1820, à 77 ans. En 1778, il n’avait alors que trente-cinq ans.
Son prédécesseur Newton, avait fait des mathématiques la discipline reine de la Royal Society. Avec Banks, ce fut bien évidemment la botanique et plus généralement les sciences naturelles qui devinrent prépondérantes, Banks prenant sous son aile les jardins botaniques royaux de Kew. Ceux-ci demeurent aujourd’hui encore la référence mondiale en matière de botanique.
Sans plus se déplacer lui-même, mais en organisateur méticuleux, le naturaliste multiplia les campagnes de récolte de plantes nouvelles, cultivées sous serre lorsqu’elles venaient de régions tropicales et à partir des jardins de Kew, ce sont des centaines de plantes ornementales ou utiles qui furent d’abord récoltées, puis étudiées et enfin, en fonction de leur intérêt, dispatchées dans le monde entier.
C’est évidemment dans ce cadre de transfert de plantes utiles que Banks, se souvenant de l’utilisation de l’arbre à pain à Tahiti, décida d’introduire celui-ci d’abord dans la Caraïbe pour nourrir à bon compte les esclaves noirs des plantations. George III, le souverain, fut enchanté par l’idée et ce fut la mise sur pied et le départ de la célèbre HMS Bounty commandée par l’inflexible capitaine Bligh. Si la mutinerie de 1789 réduisit la mission à néant, Bligh revint en 1792 et cette fois-ci réussit ; mais on le sait, ce fruit ne rencontra pas la faveur des esclaves...
Les Français 20 ans avant les Anglais !
Dans un article documenté intitulé “L’incroyable odyssée de l’arbre à pain”, Michèle Quentin raconte comment les Français, avant même Joseph Banks, s’intéressèrent au uru comme nourriture pour les esclaves des colonies. Voici ce qu’elle écrit dans le bulletin de l’Association des Parcs et Jardins en région Centre-Val de Loire, bulletin intitulé “Au cœur des jardins” (octobre 2019).
“Les Français parviennent avant les Britanniques à acclimater l’arbre à pain dans leurs colonies américaines. Cette plante ne pouvait manquer d’enflammer l’imagination des responsables des bureaux de Versailles, chargés d’assurer les subsistances du royaume, ainsi que celle des membres des sociétés d’agriculture, qui se multiplient en cette fin du XVIIIe siècle. Le but de ces sociétés est de développer les méthodes agraires –utilisation des engrais, défrichements, dessèchement de marais– et les cultures nouvelles, en particulier les plantes considérées comme “nourrissantes”, telles que la pomme de terre et le maïs, conseillé lui aussi par Parmentier, et qui doit permettre d’enrayer les disettes fréquentes. L’arbre à pain, par son nom seul, est porteur d’espérance. Féculent, il permet de mieux caler l’estomac des ouvriers des plantations... De plus, il est considéré de culture facile. Comment pouvait-on s’en procurer pour le multiplier en Europe, ou du moins, dans les possessions françaises du Nouveau Monde ? Les voyages de découverte de Bougainville, de 1766 à 1769, et de Cook, de 1768 à 1779, parmi les îles du Pacifique, font connaître à l’Europe l’existence des merveilleux fruits de l’Océanie, et vantent en particulier, l’étonnant “arbre à pain”.
En 1772, le naturaliste lyonnais Pierre Sonnerat (1748-1814) introduit et fait prospérer à l’Ile Bourbon (La Réunion), puis à l’Ile de France (île Maurice) des pieds d’arbre à pain, rapportés de son voyage en Nouvelle-Guinée et de là, à Saint-Domingue et Cayenne dès 1788. Pierre Poivre (1719-1786) “traqueur d’arbres à épices et autres” et dont les aventures rocambolesques sont dignes d’une épopée, les fait multiplier. Colbert avait ordonné aux commandants de navires d’envoyer “des plantes et des semences” lors de chaque expédition. Le botaniste Jacques-Julien Houttou de La Billardière (1755-1834) recherche le giroflier et le muscadier. En 1791, il fait partie de l’expédition d’Entrecasteaux, envoyée dans les mers australes à la recherche de La Pérouse (disparu depuis 1765). Il embarque à l’île des Amis (ndlr : Tonga) et rapporte au Jardin des Plantes de Paris de jeunes plants à l’état vivant d’arbres à pain. Ils sont élevés dans les serres du Museum et, en 1795, des taxons sont confiés à Joseph Martin pour être transportés en Guyane française (bien que Sonnerat ait introduit l’arbre quelques années auparavant...). René Desfontaines signale ces faits dans une brochure publiée en 1802. ”
“Les Français parviennent avant les Britanniques à acclimater l’arbre à pain dans leurs colonies américaines. Cette plante ne pouvait manquer d’enflammer l’imagination des responsables des bureaux de Versailles, chargés d’assurer les subsistances du royaume, ainsi que celle des membres des sociétés d’agriculture, qui se multiplient en cette fin du XVIIIe siècle. Le but de ces sociétés est de développer les méthodes agraires –utilisation des engrais, défrichements, dessèchement de marais– et les cultures nouvelles, en particulier les plantes considérées comme “nourrissantes”, telles que la pomme de terre et le maïs, conseillé lui aussi par Parmentier, et qui doit permettre d’enrayer les disettes fréquentes. L’arbre à pain, par son nom seul, est porteur d’espérance. Féculent, il permet de mieux caler l’estomac des ouvriers des plantations... De plus, il est considéré de culture facile. Comment pouvait-on s’en procurer pour le multiplier en Europe, ou du moins, dans les possessions françaises du Nouveau Monde ? Les voyages de découverte de Bougainville, de 1766 à 1769, et de Cook, de 1768 à 1779, parmi les îles du Pacifique, font connaître à l’Europe l’existence des merveilleux fruits de l’Océanie, et vantent en particulier, l’étonnant “arbre à pain”.
En 1772, le naturaliste lyonnais Pierre Sonnerat (1748-1814) introduit et fait prospérer à l’Ile Bourbon (La Réunion), puis à l’Ile de France (île Maurice) des pieds d’arbre à pain, rapportés de son voyage en Nouvelle-Guinée et de là, à Saint-Domingue et Cayenne dès 1788. Pierre Poivre (1719-1786) “traqueur d’arbres à épices et autres” et dont les aventures rocambolesques sont dignes d’une épopée, les fait multiplier. Colbert avait ordonné aux commandants de navires d’envoyer “des plantes et des semences” lors de chaque expédition. Le botaniste Jacques-Julien Houttou de La Billardière (1755-1834) recherche le giroflier et le muscadier. En 1791, il fait partie de l’expédition d’Entrecasteaux, envoyée dans les mers australes à la recherche de La Pérouse (disparu depuis 1765). Il embarque à l’île des Amis (ndlr : Tonga) et rapporte au Jardin des Plantes de Paris de jeunes plants à l’état vivant d’arbres à pain. Ils sont élevés dans les serres du Museum et, en 1795, des taxons sont confiés à Joseph Martin pour être transportés en Guyane française (bien que Sonnerat ait introduit l’arbre quelques années auparavant...). René Desfontaines signale ces faits dans une brochure publiée en 1802. ”
Des cultivars par dizaines
Un cultivar est un type végétal résultant d'une sélection, d'une mutation ou d'une hybridation (naturelle ou provoquée) et cultivé pour ses qualités agricoles. Toutes les espèces de uru viennent de la même plante originaire d'Asie et les Polynésiens sont pour beaucoup dans la multiplication de ses descendants.
Patrie de l’arbre à pain, au moins sur le plan culturel (Artocarpus altilis serait originaire de Java), la Polynésie moderne n’a pourtant jamais été capable de rendre aux anciens les honneurs qu’ils méritaient pour avoir amené dans nos îles le uru depuis la lointaine Asie du Sud-Est, en ayant réussi son acclimatation tout au long de ce parcours, et enfin –et surtout– en ayant su multiplier les variétés de cet arbre, de manière à disposer huit à dix mois de l’année d’une ressource essentielle en termes de nourriture.
Un fruit à graines
Car le uru, ou plutôt les uru, proviennent d’une seule espèce elle-même née sans doute d’un croisement. Ce uru “originel” est un fruit à graines, que l’on consomme en Asie à la façon des châtaignes en Occident. Sur les marchés, à Java par exemple, on nous a ri au nez lorsque nous avons expliqué qu’ici, à Tahiti, c’est la pulpe du uru qui était consommée. Là-bas, ce sont uniquement les graines, celles des uru huero, généralement grillées ; la pulpe, comme nous a lancé dans un grand éclat de rire une marchande javanaise “c’est juste bon pour les cochons” (sic).
En Asie du Sud-Est, ce ne sont pas les espèces de fruits et de légumes qui manquent, alors que sur leurs fragiles va’a à double coque, les migrants polynésiens arrivaient avec peu de réserves alimentaires et peu de plantes en suffisamment bon état pour être replantées dans les îles qui étaient colonisées les unes après les autres.
Les graines de uru ont donc permis l’acclimatation de cet arbre et les “mains vertes” polynésiennes, il y a des siècles, se sont ingéniées à multiplier les variétés, par hybridation et modifications génétiques, parfois infimes, parfois spectaculaires : la plus intéressante de ces modifications a sans doute été la stérilisation des arbres, de manière à ce que leurs fruits soient plus gros et surtout plus généreux en pulpe (les plus gros uru pèsent jusqu’à quatre kilos). La nourriture de base des premiers Polynésiens était en effet un cocktail mêlant poissons et uru. Or, sans doute au fil de générations d’observations, il s’avéra que le mélange poissons + pulpe était meilleur pour la santé que le mélange poissons + graines. D’où l’intérêt de parvenir à n’obtenir que des fruits sans graines, quelques uru huero étant conservés ici et là.
Des dizaines de noms
Les variétés anciennes de uru étaient très nombreuses (des dizaines) mais malheureusement, leur nombre n’a cessé de diminuer ces dernières décennies, compte tenu du fait que l’usage même des fruits de l’arbre à pain est sinon tombé en désuétude, du moins a été largement remplacé par le pain des boulangeries (le uru-punu pua’atoro demeure tout de même une tradition bien ancrée dans les familles polynésiennes, à défaut d’être très sain sur le plan diététique...).
En citant le botaniste hawaiien Arthur Whistler, aux Samoa on comptait vingt cultivars et trente-sept noms (Whistler 2001). Onze cultivars au moins étaient présents aux Tonga (Whistler 1991) ; trente-deux variétés existaient à Tahiti et vingt-six autres noms ont été recensés (Wilder, 1928). Aux Marquises, on connaissait au moins vingt-cinq cultivars et plus de deux cents appellations ont été relevées (Brown, 1935). Aux îles Fidji, treize cultivars ont été dénombrés (Seemann, 1835-1873) alors qu’il en existait sans doute nombre d’autres. Seule exception à cette richesse botanique, les îles Hawaii, où n’existait qu’un seul cultivar correspondant à la variété “ulu ea” des Samoa. Une pauvreté qui s’explique sans doute par l’introduction tardive de l’arbre dans cet archipel.
Le pharmacien Paul Pétard, qui précise que c’est l’Espagnol Quiros qui fut le premier Occidental à découvrir cet arbre, en décrivit vingt-six variétés dans ses travaux, dont le uru huero aux graines fertiles (mais très lentes à se développer, d’où la préférence donnée aux boutures de racines).
Patrie de l’arbre à pain, au moins sur le plan culturel (Artocarpus altilis serait originaire de Java), la Polynésie moderne n’a pourtant jamais été capable de rendre aux anciens les honneurs qu’ils méritaient pour avoir amené dans nos îles le uru depuis la lointaine Asie du Sud-Est, en ayant réussi son acclimatation tout au long de ce parcours, et enfin –et surtout– en ayant su multiplier les variétés de cet arbre, de manière à disposer huit à dix mois de l’année d’une ressource essentielle en termes de nourriture.
Un fruit à graines
Car le uru, ou plutôt les uru, proviennent d’une seule espèce elle-même née sans doute d’un croisement. Ce uru “originel” est un fruit à graines, que l’on consomme en Asie à la façon des châtaignes en Occident. Sur les marchés, à Java par exemple, on nous a ri au nez lorsque nous avons expliqué qu’ici, à Tahiti, c’est la pulpe du uru qui était consommée. Là-bas, ce sont uniquement les graines, celles des uru huero, généralement grillées ; la pulpe, comme nous a lancé dans un grand éclat de rire une marchande javanaise “c’est juste bon pour les cochons” (sic).
En Asie du Sud-Est, ce ne sont pas les espèces de fruits et de légumes qui manquent, alors que sur leurs fragiles va’a à double coque, les migrants polynésiens arrivaient avec peu de réserves alimentaires et peu de plantes en suffisamment bon état pour être replantées dans les îles qui étaient colonisées les unes après les autres.
Les graines de uru ont donc permis l’acclimatation de cet arbre et les “mains vertes” polynésiennes, il y a des siècles, se sont ingéniées à multiplier les variétés, par hybridation et modifications génétiques, parfois infimes, parfois spectaculaires : la plus intéressante de ces modifications a sans doute été la stérilisation des arbres, de manière à ce que leurs fruits soient plus gros et surtout plus généreux en pulpe (les plus gros uru pèsent jusqu’à quatre kilos). La nourriture de base des premiers Polynésiens était en effet un cocktail mêlant poissons et uru. Or, sans doute au fil de générations d’observations, il s’avéra que le mélange poissons + pulpe était meilleur pour la santé que le mélange poissons + graines. D’où l’intérêt de parvenir à n’obtenir que des fruits sans graines, quelques uru huero étant conservés ici et là.
Des dizaines de noms
Les variétés anciennes de uru étaient très nombreuses (des dizaines) mais malheureusement, leur nombre n’a cessé de diminuer ces dernières décennies, compte tenu du fait que l’usage même des fruits de l’arbre à pain est sinon tombé en désuétude, du moins a été largement remplacé par le pain des boulangeries (le uru-punu pua’atoro demeure tout de même une tradition bien ancrée dans les familles polynésiennes, à défaut d’être très sain sur le plan diététique...).
En citant le botaniste hawaiien Arthur Whistler, aux Samoa on comptait vingt cultivars et trente-sept noms (Whistler 2001). Onze cultivars au moins étaient présents aux Tonga (Whistler 1991) ; trente-deux variétés existaient à Tahiti et vingt-six autres noms ont été recensés (Wilder, 1928). Aux Marquises, on connaissait au moins vingt-cinq cultivars et plus de deux cents appellations ont été relevées (Brown, 1935). Aux îles Fidji, treize cultivars ont été dénombrés (Seemann, 1835-1873) alors qu’il en existait sans doute nombre d’autres. Seule exception à cette richesse botanique, les îles Hawaii, où n’existait qu’un seul cultivar correspondant à la variété “ulu ea” des Samoa. Une pauvreté qui s’explique sans doute par l’introduction tardive de l’arbre dans cet archipel.
Le pharmacien Paul Pétard, qui précise que c’est l’Espagnol Quiros qui fut le premier Occidental à découvrir cet arbre, en décrivit vingt-six variétés dans ses travaux, dont le uru huero aux graines fertiles (mais très lentes à se développer, d’où la préférence donnée aux boutures de racines).
Hawaii, temple des uru
C’est un comble : l’archipel polynésien qui ne comptait qu’une seule variété de maiore, Hawaii, est aujourd’hui la nouvelle patrie de l’arbre à pain puisque celui-ci, sur l’île de Maui, y dispose d’un conservatoire unique au monde, le Kahanu Garden abritant le Breadfruit Institute et son extraordinaire collection d’arbres à pain, représentant plus de cent cinquante variétés.
A Tahiti, où les pouvoirs publics ont longtemps parlé de créer un conservatoire de ce type, on en est resté aux déclarations d’intention suivies de bien peu d’effets, sinon une plantation modeste à Raiatea. A Hawaii, on parle moins, mais on agit. Et aujourd’hui, Maui est le temple des uru.
Cannes à sucre, bovins et enfin jardin
Au cœur du jardin botanique Kahanu Garden se trouve le Pi’ilanihale Heiau, le plus grand heiau (lieu de culte, marae) de toute la Polynésie. Zone agricole par excellence, dans le passé, le secteur de Kahanu se développa rapidement. A la fin du XVIe siècle, le célèbre chef Pi’ilani parvint à réunir l’ensemble de l’île de Maui sous une seule règle avec Kapueokahi (baie de Hana) comme l’un des centres du royaume. C’est à lui que l’on doit le nom du marae Pi’ilanihale, littéralement la maison de Pi’ilani. En 1794, Kamehameha I triompha de l’armée de Maui et petit à petit le site religieux perdit de son importance.
A partir des années 1860, la zone de Hana, intégrant le jardin botanique actuel, devint une prospère plantation de cannes à sucre, puis, à partir de 1946, un ranch d’élevage bovin. En 1974, les descendants du chef Kahanu et les propriétaires du ranch cédèrent soixante et un acres de leurs terres au Jardin botanique tropical du Pacifique en échange de la restauration et de l’entretien du Pi’ilanihale et des tombes familiales du site.
Vanilles, cocotiers, uru...
Nouveaux dons et achats portèrent cette superficie à 293 acres en 2008. Les plantations du jardin botanique commencèrent dès 1972 et grâce notamment à un employé zélé, “Oncle Bleu” (Francis Kikaha Lono de son vrai nom, qui travailla sur place jusqu’en 2001), celles-ci prirent vite une dimension culturelle très importante. Outre des plantes et arbres très variés, le Kahanu Garden s’attacha à créer des jardins à thème : le premier fut consacré à la vanille, orchidée très particulière s’il en est. Suivirent le Mary Wishard Coconut Grove avec vingt-et-une variétés de cocotiers et surtout la collection méticuleuse d’arbres à pain avec cent cinquante cultivars plantés (collection qui ne cesse de s’enrichir).
D’autres jardins relevant de l’ethnobotanique suivirent : taro, patates douces, cannes à sucre, bananes... Parallèlement, un énorme effort de restauration du Pi’ilanihale a été fait pour rendre toute sa majesté à ce lieu de culte majeur dans l’histoire de Hawaii. Le Kahanu Garden est rattaché aujourd’hui au National Tropical Botanical Garden (NTBG), une organisation à but non lucratif. Quatre jardins botaniques à Hawaii sont sous sa responsabilité et un en Floride : Allerton Garden (Kaua’i), Kahanu Garden & Preserve (Maui), Limahuli Garden & Preserve (Kaua’i), McBryde Garden (Kaua’i) et The Kampong (Floride).
Malgré sa richesse en variétés de uru, malgré l’épisode historique de la mutinerie de la Bounty, malgré ses moyens financiers considérables, la Polynésie française n’a, de son côté, jamais pu relever le défi et redonner à ce fruit central dans notre culture toute la place qu’il mérite. Peut-être un jour saura-t-on s’inspirer de ce qui a été fait à Maui...
A Tahiti, où les pouvoirs publics ont longtemps parlé de créer un conservatoire de ce type, on en est resté aux déclarations d’intention suivies de bien peu d’effets, sinon une plantation modeste à Raiatea. A Hawaii, on parle moins, mais on agit. Et aujourd’hui, Maui est le temple des uru.
Cannes à sucre, bovins et enfin jardin
Au cœur du jardin botanique Kahanu Garden se trouve le Pi’ilanihale Heiau, le plus grand heiau (lieu de culte, marae) de toute la Polynésie. Zone agricole par excellence, dans le passé, le secteur de Kahanu se développa rapidement. A la fin du XVIe siècle, le célèbre chef Pi’ilani parvint à réunir l’ensemble de l’île de Maui sous une seule règle avec Kapueokahi (baie de Hana) comme l’un des centres du royaume. C’est à lui que l’on doit le nom du marae Pi’ilanihale, littéralement la maison de Pi’ilani. En 1794, Kamehameha I triompha de l’armée de Maui et petit à petit le site religieux perdit de son importance.
A partir des années 1860, la zone de Hana, intégrant le jardin botanique actuel, devint une prospère plantation de cannes à sucre, puis, à partir de 1946, un ranch d’élevage bovin. En 1974, les descendants du chef Kahanu et les propriétaires du ranch cédèrent soixante et un acres de leurs terres au Jardin botanique tropical du Pacifique en échange de la restauration et de l’entretien du Pi’ilanihale et des tombes familiales du site.
Vanilles, cocotiers, uru...
Nouveaux dons et achats portèrent cette superficie à 293 acres en 2008. Les plantations du jardin botanique commencèrent dès 1972 et grâce notamment à un employé zélé, “Oncle Bleu” (Francis Kikaha Lono de son vrai nom, qui travailla sur place jusqu’en 2001), celles-ci prirent vite une dimension culturelle très importante. Outre des plantes et arbres très variés, le Kahanu Garden s’attacha à créer des jardins à thème : le premier fut consacré à la vanille, orchidée très particulière s’il en est. Suivirent le Mary Wishard Coconut Grove avec vingt-et-une variétés de cocotiers et surtout la collection méticuleuse d’arbres à pain avec cent cinquante cultivars plantés (collection qui ne cesse de s’enrichir).
D’autres jardins relevant de l’ethnobotanique suivirent : taro, patates douces, cannes à sucre, bananes... Parallèlement, un énorme effort de restauration du Pi’ilanihale a été fait pour rendre toute sa majesté à ce lieu de culte majeur dans l’histoire de Hawaii. Le Kahanu Garden est rattaché aujourd’hui au National Tropical Botanical Garden (NTBG), une organisation à but non lucratif. Quatre jardins botaniques à Hawaii sont sous sa responsabilité et un en Floride : Allerton Garden (Kaua’i), Kahanu Garden & Preserve (Maui), Limahuli Garden & Preserve (Kaua’i), McBryde Garden (Kaua’i) et The Kampong (Floride).
Malgré sa richesse en variétés de uru, malgré l’épisode historique de la mutinerie de la Bounty, malgré ses moyens financiers considérables, la Polynésie française n’a, de son côté, jamais pu relever le défi et redonner à ce fruit central dans notre culture toute la place qu’il mérite. Peut-être un jour saura-t-on s’inspirer de ce qui a été fait à Maui...
Les noms communs du uru
Dans toute la ceinture tropicale où pousse l’arbre à pain, celui-ci fait l’objet d’appellations très nombreuses. En voici quelques-unes (sachant que généralement, le nom vernaculaire désigne aussi bien l’arbre que le fruit) :
• árbol de pan, fruta de pan, pan, panapen, (Espagnol) • arbre à pain, fruit à pain (Français)
• beta (Vanuatu)
• bia, bulo, nimbalu (îles Salomon)
• blèfoutou, yovotévi (Bénin)
• breadfruit (Anglais)
• brotfruchtbaum (Allemand)
• broodvrucht, broodboom (Hollandais)
• buen pan (République dominicaine)
• châtaignier pays (Antilles françaises)
• cow, panbwa, pain bois, frutapan, and fruta de pan (Caraïbe)
• fruta pao, pao de massa (Portugais)
• kapiak (Papouasie Nouvelle-Guinée)
• kuru (îles Cook)
• lemai, lemae (Guam, Mariannes)
• mazapan (Guatemala, Honduras)
• meduu (Palau)
• mei, mai (Etats fédérés de Micronésie, Kiribati, îles Marshall,
Marquises, Tonga, Tuvalu)
• mos (Kosrae)
• pana, panapen (Porto Rico)
• rata del (Sri Lanka)
• rimas (Philippines)
• shelisheli (Tanzanie)
• sukun (Indonésie, Malaisie)
• ‘ulu (Hawai‘i, Samoa, Rotuma, Tuvalu)
• ‘uru (îles de la Société)
• uto, buco (Fidji)
• árbol de pan, fruta de pan, pan, panapen, (Espagnol)
• beta (Vanuatu)
• bia, bulo, nimbalu (îles Salomon)
• blèfoutou, yovotévi (Bénin)
• breadfruit (Anglais)
• brotfruchtbaum (Allemand)
• broodvrucht, broodboom (Hollandais)
• buen pan (République dominicaine)
• châtaignier pays (Antilles françaises)
• cow, panbwa, pain bois, frutapan, and fruta de pan (Caraïbe)
• fruta pao, pao de massa (Portugais)
• kapiak (Papouasie Nouvelle-Guinée)
• kuru (îles Cook)
• lemai, lemae (Guam, Mariannes)
• mazapan (Guatemala, Honduras)
• meduu (Palau)
• mei, mai (Etats fédérés de Micronésie, Kiribati, îles Marshall,
Marquises, Tonga, Tuvalu)
• mos (Kosrae)
• pana, panapen (Porto Rico)
• rata del (Sri Lanka)
• rimas (Philippines)
• shelisheli (Tanzanie)
• sukun (Indonésie, Malaisie)
• ‘ulu (Hawai‘i, Samoa, Rotuma, Tuvalu)
• ‘uru (îles de la Société)
• uto, buco (Fidji)
A lire
Paul Pétard : Plantes utiles de Polynésie (Ed. Haere Po) Réédition 2019.
Daniel Pardon : Guide des fruits de Tahiti (Ed. Au vent des îles).
Arthur Whistler : Plants of the Canoe People (Ed. National Tropical Botanical Garden).
Annie Walter/ Chanel Sam : Fruits d’Océanie (Ed. IRD Editions)
Daniel Pardon : Guide des fruits de Tahiti (Ed. Au vent des îles).
Arthur Whistler : Plants of the Canoe People (Ed. National Tropical Botanical Garden).
Annie Walter/ Chanel Sam : Fruits d’Océanie (Ed. IRD Editions)