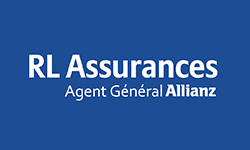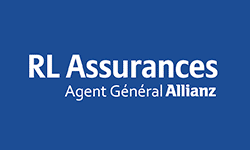Tahiti, le 21 juillet 2021 – Donatrice du programme Pew Bertarelli Ocean Legacy (PBOL) depuis sept ans, Dona Bertarelli a pris le temps de s'arrêter en Polynésie pour venir à la rencontre des communautés locales dans les archipels et recueillir leurs doléances afin de les porter aux Nations unies, dont elle est conseillère pour l'économie bleue. Nous l'avons rencontré en exclusivité.
Vous n'étiez pas venue en Polynésie depuis 27 ans, c'était important pour vous de vous arrêter ici ?
“Oui c'était important, quand on fait appel à moi et qu'on me demande de venir dans un pays, une région, une communauté pour apporter une expertise, j'aime venir voir de plus près et comprendre ce qu'il se passe. Et je n'avais pas pu le faire avec la Polynésie où nous avons commencé à travailler il y a cinq ans. Les deux premières années je pensais avoir le temps de venir et puis il y a eu le Covid. Mais il fallait absolument que je vienne faire un maximum d'atolls et que je prenne le temps, c'est-à-dire trois semaines. Les seuls endroits où je n'ai pas été encore c'est aux Marquises, aux Australes et aux Gambier. J'espère revenir l'année prochaine et pouvoir y aller et finir le tour complet”.
Vous avez déjà fait le tour des îles depuis votre arrivé en Polynésie, il y quelques jours, comment avez-vous été accueilli ?
“J'ai eu un accueil fantastique. C'est ce que j'aime faire, aller à la rencontre des communautés qui vivent de l'océan, de la nature. De les écouter, de voir leur quotidien, les opportunités et les difficultés qu'ils rencontrent à tous les niveaux. Quand je retourne en Suisse et qu'on me demande de parler aux Nations unies ou ailleurs, je cherche à porter cette voie et ce message pour faire bouger les choses à l'échelle internationale, parce qu'une communauté seule ne peut pas tout faire”.
Quel regard on porte à l'Onu sur le concept de rahui polynésien ?
“Aujourd'hui, on revient aux racines pour retrouver une harmonie. Avec le rahui on s'aperçoit que le concept d'aire marine protégée finalement n'est pas si nouveau que ça et les Polynésiens l'avaient adopté bien avant nous. Les données scientifiques, ils les avaient en observant la nature. En fonction de ça, ils se mettaient des restrictions pour protéger telle espèce ou tel espace. Dans le monde d'aujourd'hui –un monde occidental et industriel il faut le dire– on a perdu cet équilibre entre l'homme et la nature. Et aujourd'hui ça revient. D'ailleurs, les Nations unies prônent et encouragent les pays à protéger 30% des océans d'ici 2030, parce qu'on sait que production doit rimer avec protection”.
La pandémie n'a-t-elle pas changé la donne pour l'économie bleue ?
“On s'aperçoit qu'avec cette pandémie qui a mis l'économie mondiale à genou, on ne peut pas compter uniquement sur les quatre secteurs principaux de l'économie bleue que sont la pêche, le transport maritime, l'énergie et le tourisme. Avec cette crise, on l'a bien vu, ces secteurs-là ne résistent pas bien. Il faut pouvoir diversifier encore. Ce n'est pas parce qu'on va sanctuariser une partie de l'océan qu'on va forcément se priver. On conserve pour avoir plus de poissons. C'est cette sagesse du rahui qu'il faut se réapproprier. Est-ce nécessaire de manger du poisson matin, midi et soir ? Est-ce cohérant de manger du thon à Paris et dans certains pays qui ont un choix très large d'aliment, alors que trois milliards de personnes dans le monde n'ont que le poisson comme seule source de protéine ? Ce sont des problématiques globales avec des solutions qui sont souvent amenées à un niveau local par les communautés. Ces solutions, il faut les adopter à une échelle locale, régionale, et enfin internationale, parce que tout est connecté”.
Qu'est-ce qui vous fait dire que la science n'est pas suffisamment écoutée ?
“A l'arrivée de la pandémie, les décideurs ont tardé à écouter les scientifiques. On peut comprendre que les gouvernements n'aiment pas les lanceurs d'alerte, parce que ça fait peur. Cette pandémie a fait beaucoup de mal, mais s'il y a une chose qu'elle a mis en perspective, c'est qu'il faut être plus à l'écoute de la science. Cette pandémie, c'est une réalité, le changement climatique c'est une réalité, la vulnérabilité des récifs et le recul des peuplements en poisson, c'est une réalité ! Au final, nous faisons face à une question de sécurité alimentaire pour des milliards de personnes”.
C'est ce message que vous allez rapporter à l'Onu et dans les instances internationales ?
“Je ne suis qu'un haut-parleur, je vais donc porter la voix de la Polynésie qui a su préserver son patrimoine maritime, mais aussi parce qu'elle est isolée. Les pressions qu'elle subit des autres pays sont donc moins fortes. Mais elles vont arriver, il faut donc continuer à mettre en place des systèmes de protections, et s'inscrire dans une protection durable afin de laisser aux prochaines générations les moyens de subsistances nécessaires. Mais il faut le faire de manière collective. Les Nations unies sont là pour rassembler les pays et trouver des solutions collectives à la table des négociations. Un pays ne peut pas faire des efforts tout seul dans son coin. Actuellement ils sont en train de tenter d'arrêter les subventions de pêches néfastes, qui sont vraiment une plaie pour les océans. S'il n'y avait pas ces subventions, les bateaux de pêches qui s'agglutinent aux frontières de la ZEE polynésienne ne viendraient pas jusque-là. Ça m'inspire de voir que les communautés locales font des efforts à leurs échelles et qu'ils attendent que la communauté régionale et internationale fasse sa part”.
Vous n'étiez pas venue en Polynésie depuis 27 ans, c'était important pour vous de vous arrêter ici ?
“Oui c'était important, quand on fait appel à moi et qu'on me demande de venir dans un pays, une région, une communauté pour apporter une expertise, j'aime venir voir de plus près et comprendre ce qu'il se passe. Et je n'avais pas pu le faire avec la Polynésie où nous avons commencé à travailler il y a cinq ans. Les deux premières années je pensais avoir le temps de venir et puis il y a eu le Covid. Mais il fallait absolument que je vienne faire un maximum d'atolls et que je prenne le temps, c'est-à-dire trois semaines. Les seuls endroits où je n'ai pas été encore c'est aux Marquises, aux Australes et aux Gambier. J'espère revenir l'année prochaine et pouvoir y aller et finir le tour complet”.
Vous avez déjà fait le tour des îles depuis votre arrivé en Polynésie, il y quelques jours, comment avez-vous été accueilli ?
“J'ai eu un accueil fantastique. C'est ce que j'aime faire, aller à la rencontre des communautés qui vivent de l'océan, de la nature. De les écouter, de voir leur quotidien, les opportunités et les difficultés qu'ils rencontrent à tous les niveaux. Quand je retourne en Suisse et qu'on me demande de parler aux Nations unies ou ailleurs, je cherche à porter cette voie et ce message pour faire bouger les choses à l'échelle internationale, parce qu'une communauté seule ne peut pas tout faire”.
Quel regard on porte à l'Onu sur le concept de rahui polynésien ?
“Aujourd'hui, on revient aux racines pour retrouver une harmonie. Avec le rahui on s'aperçoit que le concept d'aire marine protégée finalement n'est pas si nouveau que ça et les Polynésiens l'avaient adopté bien avant nous. Les données scientifiques, ils les avaient en observant la nature. En fonction de ça, ils se mettaient des restrictions pour protéger telle espèce ou tel espace. Dans le monde d'aujourd'hui –un monde occidental et industriel il faut le dire– on a perdu cet équilibre entre l'homme et la nature. Et aujourd'hui ça revient. D'ailleurs, les Nations unies prônent et encouragent les pays à protéger 30% des océans d'ici 2030, parce qu'on sait que production doit rimer avec protection”.
La pandémie n'a-t-elle pas changé la donne pour l'économie bleue ?
“On s'aperçoit qu'avec cette pandémie qui a mis l'économie mondiale à genou, on ne peut pas compter uniquement sur les quatre secteurs principaux de l'économie bleue que sont la pêche, le transport maritime, l'énergie et le tourisme. Avec cette crise, on l'a bien vu, ces secteurs-là ne résistent pas bien. Il faut pouvoir diversifier encore. Ce n'est pas parce qu'on va sanctuariser une partie de l'océan qu'on va forcément se priver. On conserve pour avoir plus de poissons. C'est cette sagesse du rahui qu'il faut se réapproprier. Est-ce nécessaire de manger du poisson matin, midi et soir ? Est-ce cohérant de manger du thon à Paris et dans certains pays qui ont un choix très large d'aliment, alors que trois milliards de personnes dans le monde n'ont que le poisson comme seule source de protéine ? Ce sont des problématiques globales avec des solutions qui sont souvent amenées à un niveau local par les communautés. Ces solutions, il faut les adopter à une échelle locale, régionale, et enfin internationale, parce que tout est connecté”.
Qu'est-ce qui vous fait dire que la science n'est pas suffisamment écoutée ?
“A l'arrivée de la pandémie, les décideurs ont tardé à écouter les scientifiques. On peut comprendre que les gouvernements n'aiment pas les lanceurs d'alerte, parce que ça fait peur. Cette pandémie a fait beaucoup de mal, mais s'il y a une chose qu'elle a mis en perspective, c'est qu'il faut être plus à l'écoute de la science. Cette pandémie, c'est une réalité, le changement climatique c'est une réalité, la vulnérabilité des récifs et le recul des peuplements en poisson, c'est une réalité ! Au final, nous faisons face à une question de sécurité alimentaire pour des milliards de personnes”.
C'est ce message que vous allez rapporter à l'Onu et dans les instances internationales ?
“Je ne suis qu'un haut-parleur, je vais donc porter la voix de la Polynésie qui a su préserver son patrimoine maritime, mais aussi parce qu'elle est isolée. Les pressions qu'elle subit des autres pays sont donc moins fortes. Mais elles vont arriver, il faut donc continuer à mettre en place des systèmes de protections, et s'inscrire dans une protection durable afin de laisser aux prochaines générations les moyens de subsistances nécessaires. Mais il faut le faire de manière collective. Les Nations unies sont là pour rassembler les pays et trouver des solutions collectives à la table des négociations. Un pays ne peut pas faire des efforts tout seul dans son coin. Actuellement ils sont en train de tenter d'arrêter les subventions de pêches néfastes, qui sont vraiment une plaie pour les océans. S'il n'y avait pas ces subventions, les bateaux de pêches qui s'agglutinent aux frontières de la ZEE polynésienne ne viendraient pas jusque-là. Ça m'inspire de voir que les communautés locales font des efforts à leurs échelles et qu'ils attendent que la communauté régionale et internationale fasse sa part”.
Femme d'affaires, navigatrice, philanthrope
Co-fondatrice de Spindrift racing, première navigatrice à remporter le prestigieux Bol d'Or Mirabaud, co-présidente de la Bertarelli Foundation et depuis l'année dernière conseillère de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) pour l'économie bleue. Femme d'affaires, navigatrice hors pair et philanthrope, Dona Bertarelli cumule les casquettes. Convaincue qu'une reprise économique mondiale ne peut se faire qu'avec un plan de préservation des océans, la femme d'affaires suisse d'origine italienne investi son temps et sa fortune au service de sa passion : la mer. Créée en 2010, la fondation Bertarelli œuvre à créer des zones marines protégées dans le monde entier et à développer la connaissance de la science marine. Depuis qu'elle s'est associée à l'ONG Pew Charitable Trusts en 2017 pour le projet “Héritage des océans”, elle estime avoir contribué à la protection de 8 millions de kilomètres carrés d'océan.