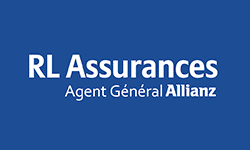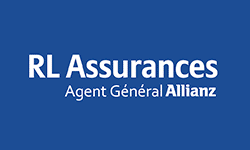Tahiti, le 21 mars 2021 - Langue de prestige maîtrisée par les sphères dirigeantes ou intellectuelles, le reo tahiti souffre de nombreuses représentations négatives dans le secondaire, résultat d’une "orientation par le bas" dans un contexte postcolonial, déduit la thèse soutenu jeudi à l’UPF par Lovaina Rochette sur "l'enseignement de la langue tahitienne aujourd'hui dans le second degré à Tahiti : entre tensions pédagogiques et ambiguïtés culturelles".
Vous évoquez une "résistance" de la langue tahitienne dans le secondaire, pourquoi ?
"Je me suis demandé en quoi l’enseignement du tahitien n’avait pas plus de succès que ça dans le second degré alors qu’elle est bien enseignée, qu’il existe un Capes et qu’il y a un consensus politique en faveur des LCP (langue et culture polynésienne) dans un contexte postcolonial. Je suis partie des travaux des sociolinguistes Mirose Paia et Jacques Vernaudon, qui ont écrit "Le tahitien, plus de prestige et moins de locuteur". Un titre qui veut tout dire et qui met en exergue une situation alarmante. Le constat aujourd’hui c’est que le tahitien est une langue de prestige parlée par l’élite religieuse, politique et académique. C’est une langue maîtrisée par les sphères dirigeantes ou intellectuelles, et pourtant c’est une langue peu pratiquée et peu transmise dans les familles. L’objet de ma thèse était de mettre en lumière les problèmes qui font résistance à cet enseignement."
Il s’agit de comprendre ce paradoxe ?
"Je pars de ce paradoxe-là. Je tente de comprendre quels sont les obstacles ? Viennent-ils de l’intérieur ou de l’extérieur ? Je me suis appuyée sur les travaux de revitalisation linguistique qui consistent à remettre le reo tahiti dans le premier degré, comme l’enseignement du reo ma’ohi au cycle 3 ou l’enseignement plurilingue (école POM, Ndlr) qui ont commencé en 2004. Les résultats montrent que ces travaux de revitalisation portent leurs fruits, que le fait de renforcer le reo tahiti en primaire permet de renforcer l’estime de soi et de mieux apprendre le français. L’une des plus grandes frayeurs des familles c’est qu’en apprenant le tahitien, on parle moins bien le français, c’est le résultat d’une idéologie, une culture monolingue, mais ce n’est pas de la faute des familles. Quand le CEP est arrivé dans les années 60 et qu’il fallait apprendre le français pour avoir un travail, beaucoup de parents ont associé le français à la réussite. Certains ont dénigré le tahitien, tandis que d’autres ont continué à parler le tahitien à la maison et le français à l’école."
Exergue : "Il fallait apprendre le français pour avoir un travail"
Quels sont les enjeux de l’enseignement du reo Tahiti ?
"On dit souvent qu’il faut enseigner le reo tahiti pour trois raisons : patrimoniale, pédagogique et politique. Politique parce qu’il s’agit de réparer les torts de la colonisation. Comme pour les langues régionales, le reo tahiti a été interdit. C’est ce qu’on appelle la politique d’assimilation. On privilégie le français au détriment du tahitien. C’était pareil pour le corse, le basque, le catalan ou l’occitan. Ce qu’on appelle "le symbole". Quand un enfant parlait sa langue il portait un cloche de vache, en guise d’humiliation, il ne fallait pas parler le patois. Ici c’était le coquillage. L’enfant était puni et tout le monde le savait. En Nouvelle-Calédonie aussi ils ont subi ça.
Je suis parti de là et j’ai mené des enquêtes pendant deux ans sur trois volets et mené une centaine d’entretiens avec les apprenants -de la sixième à la terminale- les enseignants de langue polynésienne et deux chefs d’établissements."
Votre thèse évoque des "tensions pédagogiques" et des "ambiguïtés culturelles", l’enseignement du tahitien fait-il l’objet d’un malaise ?
"Il y a des frustrations, des crispations, des non-dits, voire des violences verbales. Qu’est-ce qu’il se passe en classe ? Qu’est-ce que ça génère ? Il y a une certaine ambivalence dans le rapport à la langue et à la culture. Les résultats de ces entretiens ont montré par exemple que chez de nombreux jeunes, et notamment chez des demis, le tahitien est souvent associé à la colère, à la honte, à l’incapacité. Le simple fait de parler fait honte, ça veut dire que t’es nul ou que tu n’as pas d’envie. Ce sont des notions négatives. Pour d’autres c’est la langue de l’émotion, de la spontanéité, comme pour les gros mots. D’autres encore sont conscients que la langue est un lien fort avec leurs ancêtres. Ils sont aussi très nombreux à vivre dans la honte de ne pas le parler. Dans côté ou de l’autre, il y a un malaise chez les élèves. Quand ils sont locuteurs, ils ont honte parce que le regard des autres est lourd de préjugés. Et quand ils ne le parlent pas, ils ont aussi honte. C’est ce qui m’a le plus touchée."
Vous évoquez une "résistance" de la langue tahitienne dans le secondaire, pourquoi ?
"Je me suis demandé en quoi l’enseignement du tahitien n’avait pas plus de succès que ça dans le second degré alors qu’elle est bien enseignée, qu’il existe un Capes et qu’il y a un consensus politique en faveur des LCP (langue et culture polynésienne) dans un contexte postcolonial. Je suis partie des travaux des sociolinguistes Mirose Paia et Jacques Vernaudon, qui ont écrit "Le tahitien, plus de prestige et moins de locuteur". Un titre qui veut tout dire et qui met en exergue une situation alarmante. Le constat aujourd’hui c’est que le tahitien est une langue de prestige parlée par l’élite religieuse, politique et académique. C’est une langue maîtrisée par les sphères dirigeantes ou intellectuelles, et pourtant c’est une langue peu pratiquée et peu transmise dans les familles. L’objet de ma thèse était de mettre en lumière les problèmes qui font résistance à cet enseignement."
Il s’agit de comprendre ce paradoxe ?
"Je pars de ce paradoxe-là. Je tente de comprendre quels sont les obstacles ? Viennent-ils de l’intérieur ou de l’extérieur ? Je me suis appuyée sur les travaux de revitalisation linguistique qui consistent à remettre le reo tahiti dans le premier degré, comme l’enseignement du reo ma’ohi au cycle 3 ou l’enseignement plurilingue (école POM, Ndlr) qui ont commencé en 2004. Les résultats montrent que ces travaux de revitalisation portent leurs fruits, que le fait de renforcer le reo tahiti en primaire permet de renforcer l’estime de soi et de mieux apprendre le français. L’une des plus grandes frayeurs des familles c’est qu’en apprenant le tahitien, on parle moins bien le français, c’est le résultat d’une idéologie, une culture monolingue, mais ce n’est pas de la faute des familles. Quand le CEP est arrivé dans les années 60 et qu’il fallait apprendre le français pour avoir un travail, beaucoup de parents ont associé le français à la réussite. Certains ont dénigré le tahitien, tandis que d’autres ont continué à parler le tahitien à la maison et le français à l’école."
Exergue : "Il fallait apprendre le français pour avoir un travail"
Quels sont les enjeux de l’enseignement du reo Tahiti ?
"On dit souvent qu’il faut enseigner le reo tahiti pour trois raisons : patrimoniale, pédagogique et politique. Politique parce qu’il s’agit de réparer les torts de la colonisation. Comme pour les langues régionales, le reo tahiti a été interdit. C’est ce qu’on appelle la politique d’assimilation. On privilégie le français au détriment du tahitien. C’était pareil pour le corse, le basque, le catalan ou l’occitan. Ce qu’on appelle "le symbole". Quand un enfant parlait sa langue il portait un cloche de vache, en guise d’humiliation, il ne fallait pas parler le patois. Ici c’était le coquillage. L’enfant était puni et tout le monde le savait. En Nouvelle-Calédonie aussi ils ont subi ça.
Je suis parti de là et j’ai mené des enquêtes pendant deux ans sur trois volets et mené une centaine d’entretiens avec les apprenants -de la sixième à la terminale- les enseignants de langue polynésienne et deux chefs d’établissements."
Votre thèse évoque des "tensions pédagogiques" et des "ambiguïtés culturelles", l’enseignement du tahitien fait-il l’objet d’un malaise ?
"Il y a des frustrations, des crispations, des non-dits, voire des violences verbales. Qu’est-ce qu’il se passe en classe ? Qu’est-ce que ça génère ? Il y a une certaine ambivalence dans le rapport à la langue et à la culture. Les résultats de ces entretiens ont montré par exemple que chez de nombreux jeunes, et notamment chez des demis, le tahitien est souvent associé à la colère, à la honte, à l’incapacité. Le simple fait de parler fait honte, ça veut dire que t’es nul ou que tu n’as pas d’envie. Ce sont des notions négatives. Pour d’autres c’est la langue de l’émotion, de la spontanéité, comme pour les gros mots. D’autres encore sont conscients que la langue est un lien fort avec leurs ancêtres. Ils sont aussi très nombreux à vivre dans la honte de ne pas le parler. Dans côté ou de l’autre, il y a un malaise chez les élèves. Quand ils sont locuteurs, ils ont honte parce que le regard des autres est lourd de préjugés. Et quand ils ne le parlent pas, ils ont aussi honte. C’est ce qui m’a le plus touchée."
"D'un côté ou de l’autre, il y a un malaise"
Dans ce contexte, l’option tahitien dans le secondaire n’est pas forcément valorisée ?
"Non, d’autant que pour les élèves qui veulent choisir 'espagnol' par exemple, si le conseil de classe juge que leurs résultats ne sont pas assez bons, ils sont envoyés en LCP. On a donc jugé qu’ils n’avaient pas les moyens cognitifs d’aller en espagnol. C’était l’une de mes hypothèses de travail : les indésirables relégués en LCP, comme si c’était une classe par défaut. Je me suis demandé si c’était un cas isolé ou une pratique courante. Et mes recherches ont montré qu’aujourd’hui, il y a toujours une orientation par le bas. Ce qui est dingue, parce que les jeunes finissent par se mettre dans le crâne qu’ils sont nuls. Quel message on leur renvoie ? Des enfants qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas compris, souffrent et peuvent devenir violents, démotivés, perturbateurs. Les études montrent aujourd’hui qu’il faut tenir compte de la motivation de l’apprenant."
Comment font les enseignants LCP pour gérer ces élèves ?
"Ils se retrouvent dans un désarroi, un isolement didactique, voire un piétinement. Le problème en LCP c’est qu’ils ne savent pas vers quelle institution se tourner, il y a un manque de cadrage et tout un panel d’obstacles. Ils font des pieds et des mains pour trouver des activités à leurs élèves. Dans ma thèse je parle de discipline à la marge, puisque chargée d’enjeux, c’est une discipline qui touche à l’identité."
"Non, d’autant que pour les élèves qui veulent choisir 'espagnol' par exemple, si le conseil de classe juge que leurs résultats ne sont pas assez bons, ils sont envoyés en LCP. On a donc jugé qu’ils n’avaient pas les moyens cognitifs d’aller en espagnol. C’était l’une de mes hypothèses de travail : les indésirables relégués en LCP, comme si c’était une classe par défaut. Je me suis demandé si c’était un cas isolé ou une pratique courante. Et mes recherches ont montré qu’aujourd’hui, il y a toujours une orientation par le bas. Ce qui est dingue, parce que les jeunes finissent par se mettre dans le crâne qu’ils sont nuls. Quel message on leur renvoie ? Des enfants qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas compris, souffrent et peuvent devenir violents, démotivés, perturbateurs. Les études montrent aujourd’hui qu’il faut tenir compte de la motivation de l’apprenant."
Comment font les enseignants LCP pour gérer ces élèves ?
"Ils se retrouvent dans un désarroi, un isolement didactique, voire un piétinement. Le problème en LCP c’est qu’ils ne savent pas vers quelle institution se tourner, il y a un manque de cadrage et tout un panel d’obstacles. Ils font des pieds et des mains pour trouver des activités à leurs élèves. Dans ma thèse je parle de discipline à la marge, puisque chargée d’enjeux, c’est une discipline qui touche à l’identité."
"Des enfants qui ne sont pas compris peuvent devenir violents"
D’où le malaise qui touche de nombreux jeunes ?
"Oui et c’est normal qu’il y ait une surenchère identitaire. Tout le monde cherche sa place, on n’est pas Tahitien, ni Français, ni Chinois… On est quoi ? On n’est pas à l’aise avec cette pluri-culturalité, c’est pour ça que le rapport à la langue est ambivalent parce qu’il y a des manques. A la maison, à l’école, dans les programmes d’histoire-géo, de français ou de math, il manque quelque chose."
Les enseignants de LCP doivent faire preuve d’innovation pour combler ce manque ?
"Tout le temps, parce qu’ils sont tous les jours au contact de ces difficultés. Les élèves le disent, 'avec le prof de tahitien c’est différent, il ou elle, nous écoute'. Ils se retrouvent en LCP parce qu’on n’a pas voulu d’eux ailleurs. L’enseignant doit donc tenir compte du contexte social, psychologique de cet être qui est devant lui dans toute sa complexité. Il ne peut pas copier-coller sur le système franco-français, ça ne marche pas. En reo tahiti, ils commencent par faire travailler les élèves démotivés sur l’origine de leur mal, travailler sur des notions comme le 'ha’ama' qui veut dire 'honte' et le 'ha’ama’au' qui veut dire 'faire le pitre'. Ce qui permet de déconstruire les représentations et d’extérioriser le malaise. Derrière, ils ont recours à la pédagogie de projet. Ils montent des projets qui ont tous en commun la culture, la langue qui est au centre : le ‘orero, le ahima’a, le 'ori Tahiti."
Comme le Heiva taure’a organisé par les collégiens ?
"Le Heiva taure’a en est un très bon exemple. Cette manifestation culturelle est partie des enseignants LCP du secondaire pour aider ces élèves à déconstruire leurs représentations négatives de la langue. Ce qui passe par l’écriture. Les apprenants ont commencé à écrire leur discours, à trouver les gestes et la mélodie. Mettre en spectacle ce que les élèves ont produit en classe, c’est un projet transdisciplinaire. Le prof de reo travail avec le prof de techno, le prof de musique ou d’histoire-géo. Ça fonctionne parce que les apprenants ont un objectif précis. Ils ont réussi à faire sortir des élèves du mutisme comme ça, parce qu’ils ont mis les élèves au milieu de leur contexte culturel. Ce qui donne du sens et instaure un climat de confiance, de bienveillance et d’écoute."
"Oui et c’est normal qu’il y ait une surenchère identitaire. Tout le monde cherche sa place, on n’est pas Tahitien, ni Français, ni Chinois… On est quoi ? On n’est pas à l’aise avec cette pluri-culturalité, c’est pour ça que le rapport à la langue est ambivalent parce qu’il y a des manques. A la maison, à l’école, dans les programmes d’histoire-géo, de français ou de math, il manque quelque chose."
Les enseignants de LCP doivent faire preuve d’innovation pour combler ce manque ?
"Tout le temps, parce qu’ils sont tous les jours au contact de ces difficultés. Les élèves le disent, 'avec le prof de tahitien c’est différent, il ou elle, nous écoute'. Ils se retrouvent en LCP parce qu’on n’a pas voulu d’eux ailleurs. L’enseignant doit donc tenir compte du contexte social, psychologique de cet être qui est devant lui dans toute sa complexité. Il ne peut pas copier-coller sur le système franco-français, ça ne marche pas. En reo tahiti, ils commencent par faire travailler les élèves démotivés sur l’origine de leur mal, travailler sur des notions comme le 'ha’ama' qui veut dire 'honte' et le 'ha’ama’au' qui veut dire 'faire le pitre'. Ce qui permet de déconstruire les représentations et d’extérioriser le malaise. Derrière, ils ont recours à la pédagogie de projet. Ils montent des projets qui ont tous en commun la culture, la langue qui est au centre : le ‘orero, le ahima’a, le 'ori Tahiti."
Comme le Heiva taure’a organisé par les collégiens ?
"Le Heiva taure’a en est un très bon exemple. Cette manifestation culturelle est partie des enseignants LCP du secondaire pour aider ces élèves à déconstruire leurs représentations négatives de la langue. Ce qui passe par l’écriture. Les apprenants ont commencé à écrire leur discours, à trouver les gestes et la mélodie. Mettre en spectacle ce que les élèves ont produit en classe, c’est un projet transdisciplinaire. Le prof de reo travail avec le prof de techno, le prof de musique ou d’histoire-géo. Ça fonctionne parce que les apprenants ont un objectif précis. Ils ont réussi à faire sortir des élèves du mutisme comme ça, parce qu’ils ont mis les élèves au milieu de leur contexte culturel. Ce qui donne du sens et instaure un climat de confiance, de bienveillance et d’écoute."