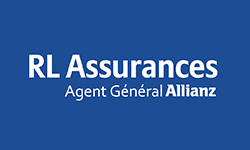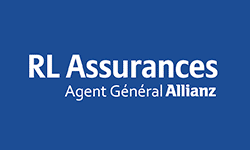Une enquête menée en milieu scolaire a permis de dresser un bilan épidémiologique et sociologique de la situation en matière de consommation de substances psychoactives (licites et illicites) chez les jeunes polynésiens. Les résultats de cette enquête ont été présentés à la presse par Madame Marie Françoise BRIGIROUX, responsable du CCSAT ( Centre de Consultations Spécialisées en Alcoologie et Toxicomanie) en présence du Dr Charles TETARIA, Ministre de la santé, de Mr Tauhiti NENA Ministre de l’éducation de Dominique MARGHEM, Directeur de la Santé et de leurs collaborateurs.
Cette enquête menée en 2009 auprès d'une population âgée de 10 à 19 ans ( de la 6ème à la terminale) a été réalisée avec la complicité des personnels enseignants et des infirmiers scolaires scolaires sous la forme d'un questionnaire auto-administré anonyme. Une précédente enquête menée en 1999 a permis d'établir des comparaisons quant à l'évolution de certains indicateurs. Une comparaison a également put être établie avec la situation observée en France métropolitaine. Ainsi il a été possible d'identifier certaines pratiques et d'évaluer les connaissances et les représentations des jeunes sur les drogues dans le but de tirer des conclusions en termes d'actions de prévention en regard des résultats observés.
L'enquête a été réalisée sur l'ensemble du territoire de Polynésie française, sur un échantillon de 4 100 élèves, répartis dans 229 classes et 61 établissements des 5 archipels du Pays avec le soutien méthodologique et technique de l'ISPF.
Cette enquête menée en 2009 auprès d'une population âgée de 10 à 19 ans ( de la 6ème à la terminale) a été réalisée avec la complicité des personnels enseignants et des infirmiers scolaires scolaires sous la forme d'un questionnaire auto-administré anonyme. Une précédente enquête menée en 1999 a permis d'établir des comparaisons quant à l'évolution de certains indicateurs. Une comparaison a également put être établie avec la situation observée en France métropolitaine. Ainsi il a été possible d'identifier certaines pratiques et d'évaluer les connaissances et les représentations des jeunes sur les drogues dans le but de tirer des conclusions en termes d'actions de prévention en regard des résultats observés.
L'enquête a été réalisée sur l'ensemble du territoire de Polynésie française, sur un échantillon de 4 100 élèves, répartis dans 229 classes et 61 établissements des 5 archipels du Pays avec le soutien méthodologique et technique de l'ISPF.
Synthèse de l'enquête : Les pratiques addictives des jeunes Polynésiens
Estime de soi, stress et dépression
D’une manière générale, les adolescents polynésiens aiment l’école même si leur taux d’absentéisme est important. Leurs joies viennent de la famille et de leurs amis et leurs préoccupations portent comme tous les jeunes de leur âge sur l’orientation scolaire et le choix d’un métier.
Ils mettent l’accent sur leurs désirs d’information en matière de santé (sexualité, alimentation….) et expriment clairement leurs besoins sur des thèmes non exprimés dans les enquêtes précédentes : avoir confiance en soi (28%), gérer le stress (21%), faire face à l’influence des autres (11%). Ces thèmes font écho aux résultats obtenus avec l’exploration par l’échelle ADRS de l’état anxio-dépressif dont souffrent certains adolescents et particulièrement les adolescentes en Polynésie.( 27% déclarent présenter une dépression modérée ou patente).
Les liens avec les usages de substances psychoactives semblent très forts, que ce soit pour le tabac (41% des fumeurs quotidiens présentent des signes de dépression contre seulement 25% des non fumeurs), le paka (42% des usagers à problème de paka présentent des signes de dépression contre 27% des non usagers ou des usagers simples) ou encore les boissons alcoolisées (44% des buveurs réguliers présentent des signes de dépression contre 26% des jeunes n’ayant pas bu au cours du mois).
Alcool: des usages à risque fréquents concernant autant les filles que les garçons
Globalement, l’usage régulier d’alcool apparaît lié à l’intensité dépressive ainsi qu’à l’absentéisme et à une scolarité marquée par des difficultés. Il concerne 7 % des jeunes Polynésiens.
L’âge du premier verre s’avère très jeune puisque un tiers des consommateurs a bu avant l’âge de 10 ans et la moitié avant l’âge de 12 ans. L’expérimentation de l’ivresse augmente également avec l’âge. Par rapport à 1999, le taux d’expérimentation d’alcool et de l’ivresse s’avère plus élevé quelle que soit la classe d’âge. Au global, 32 % des élèves avaient déjà été ivres en 1999 contre 44 % en 2009. Les jeunes Polynésiens semblent finalement consommer moins fréquemment de boissons alcoolisées qu’en métropole, mais de manière plus excessive et avec peu de distinction entre les sexes. L’expérimentation de l’ivresse apparaît plutôt plus fréquente en Polynésie, essentiellement parmi les filles (57 % contre 45% en métropole), il en va de même pour les épisodes d’alcoolisation importante.
Tabac : un tabagisme très présent, en particulier chez les filles
En 2009, l’usage quotidien de tabac concerne 14 % des jeunes Polynésiens, les filles (18 %) nettement plus que les garçons (10 %), constituant de ce fait une cible à privilégier en matière de prévention primaire du tabagisme. Le niveau de tabagisme apparaît en hausse par rapport à 1999. Il en va de même en ce qui concerne le pourcentage de fumeurs ayant commencé avant l’âge de 12 ans. Ils étaient 23% en 1999 contre 50% en 2009. Alors que la consommation de tabac chez les jeunes garçons polynésiens s’avère bien inférieure à celle observée en métropole, les filles ont un niveau de consommation du même ordre et très supérieur à celui des garçons. De ce fait, l’intensité dépressive ainsi qu’une mauvaise moyenne scolaire apparaissent également très liés à l’expérimentation de tabac.
Pakalolo : très présent dans le quotidien des jeunes Polynésiens
Au global, l’expérimentation de paka concerne 29 % des jeunes Polynésiens, soit un tiers des garçons (33 %) et un peu plus d’un quart des filles (26 %). Par ailleurs, selon le CAST, échelle de repérage de l’usage problématique de cannabis, 13 % des garçons et 9 % des filles présenteraient un usage « à risque » de paka, tandis que respectivement 4 % et 2 % seraient déjà dans un usage problématique de ce produit. Comme cela est également observé en France métropolitaine, l’usage occasionnel du paka se révèle particulièrement lié aux opportunités de contact avec ce produit. En revanche, le basculement vers un usage problématique apparaît plus lié au niveau anxio-dépressif.
Les autres drogues rarement expérimentées
Les niveaux d’expérimentation des drogues illicites autres que le paka apparaissent bien inférieurs à ceux observés pour ce dernier. Lorsqu’elle a lieu, la rencontre avec les autres drogues se fait majoritairement après 16 ans. Là encore, leur expérimentation est associée à l’absentéisme scolaire et au niveau de dépression. Par ailleurs, elle concerne de manière plus importante les jeunes habitant dans les zones urbaines des Iles du vent.
En conclusion
Les résultats de cette enquête rejoignent pour beaucoup les constats des professionnels de terrain côtoyant les adolescents polynésiens. Ils montrent que l’usage de produits psychotropes a augmenté en dix ans, marquée par une hausse plus forte chez les filles, en particulier pour la consommation d’alcool. Une certaine baisse de l’âge d’entrée dans les consommations (voir l’ouvrage pour le détail) fait également écho aux observations de terrain, laissant supposer une banalisation de ces pratiques malgré une bonne connaissance des risques encourus. Ce point est important car la précocité du premier usage d’un produit est un facteur favorisant la poursuite de la consommation et l’installation d’un usage problématique.
Face à la constatation de l’augmentation de la consommation de tabac, d’alcool et de paka par les adolescentes polynésiennes en dix ans, il apparaît que le niveau de connaissances sur les risques ne fait pas défaut et que les messages de prévention véhiculés depuis plusieurs années ont été entendus. Mais ils se heurtent, dans cette société aux pratiques bien ancrées de consommation associée à la fête, à la disponibilité des produits et au fait que l’alcool et le cannabis apparaissent souvent comme le seul moyen de supporter les difficultés de la vie. Il est important, avant de se lancer dans des actions ciblant les filles, de les écouter pour mieux comprendre ce qui les poussent à vouloir consommer comme les garçons : place dans la société mal définie, moyen de s’imposer ou de se faire respecter, stress plus important ?
Dans le cadre du programme de lutte contre l’alcool et la toxicomanie de 2009, plusieurs pistes peuvent être préconisées afin d’endiguer la hausse de la consommation. Face aux demandes des élèves en matière d’information sur l’amélioration de la confiance en soi ou sur la gestion du stress, nos résultats confirment la nécessité de mettre en place le programme basé sur le développement des compétences personnelles et sociales pour une prévention plus large des déviances. Apprendre à gérer ses émotions et ses frustrations dès la petite enfance constitue en effet un moyen efficace d’aider les jeunes à ne pas basculer dans un usage à risque dans un pays où la honte de parler de soi et de ce que l’on ressent est parfois très forte. Des actions allant dans ce sens ont d’ailleurs été inscrites dans le programme de lutte contre l'alcool et la toxicomanie 2009-2013.
* Enquête ECAAP 2009 à télécharger sur : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1341.pdf
** contact référent santé : Dr Marie Françoise BRUGIROUX, Responsable du CCSAT
Tél 46 00 67 / Adresse mail : marie.francoise.brugiroux@sante.gov.pf
Références
[1] Beck F., Brugiroux M.-F., Cerf N. (dir.), Les conduites addictives des adolescents polynésiens. Enquête Ecaap 2009. Saint-Denis : Inpes, collection Études santé, 2010 : 200 p.
[2] Brugiroux M.-F. Les jeunes et la drogue : enquête CAP chez les jeunes scolarisés de 10 à 20 ans en Polynésie française. Papeete : ministère de la Santé, direction de la Santé, mars 2000 : 63 p.
« »
D’une manière générale, les adolescents polynésiens aiment l’école même si leur taux d’absentéisme est important. Leurs joies viennent de la famille et de leurs amis et leurs préoccupations portent comme tous les jeunes de leur âge sur l’orientation scolaire et le choix d’un métier.
Ils mettent l’accent sur leurs désirs d’information en matière de santé (sexualité, alimentation….) et expriment clairement leurs besoins sur des thèmes non exprimés dans les enquêtes précédentes : avoir confiance en soi (28%), gérer le stress (21%), faire face à l’influence des autres (11%). Ces thèmes font écho aux résultats obtenus avec l’exploration par l’échelle ADRS de l’état anxio-dépressif dont souffrent certains adolescents et particulièrement les adolescentes en Polynésie.( 27% déclarent présenter une dépression modérée ou patente).
Les liens avec les usages de substances psychoactives semblent très forts, que ce soit pour le tabac (41% des fumeurs quotidiens présentent des signes de dépression contre seulement 25% des non fumeurs), le paka (42% des usagers à problème de paka présentent des signes de dépression contre 27% des non usagers ou des usagers simples) ou encore les boissons alcoolisées (44% des buveurs réguliers présentent des signes de dépression contre 26% des jeunes n’ayant pas bu au cours du mois).
Alcool: des usages à risque fréquents concernant autant les filles que les garçons
Globalement, l’usage régulier d’alcool apparaît lié à l’intensité dépressive ainsi qu’à l’absentéisme et à une scolarité marquée par des difficultés. Il concerne 7 % des jeunes Polynésiens.
L’âge du premier verre s’avère très jeune puisque un tiers des consommateurs a bu avant l’âge de 10 ans et la moitié avant l’âge de 12 ans. L’expérimentation de l’ivresse augmente également avec l’âge. Par rapport à 1999, le taux d’expérimentation d’alcool et de l’ivresse s’avère plus élevé quelle que soit la classe d’âge. Au global, 32 % des élèves avaient déjà été ivres en 1999 contre 44 % en 2009. Les jeunes Polynésiens semblent finalement consommer moins fréquemment de boissons alcoolisées qu’en métropole, mais de manière plus excessive et avec peu de distinction entre les sexes. L’expérimentation de l’ivresse apparaît plutôt plus fréquente en Polynésie, essentiellement parmi les filles (57 % contre 45% en métropole), il en va de même pour les épisodes d’alcoolisation importante.
Tabac : un tabagisme très présent, en particulier chez les filles
En 2009, l’usage quotidien de tabac concerne 14 % des jeunes Polynésiens, les filles (18 %) nettement plus que les garçons (10 %), constituant de ce fait une cible à privilégier en matière de prévention primaire du tabagisme. Le niveau de tabagisme apparaît en hausse par rapport à 1999. Il en va de même en ce qui concerne le pourcentage de fumeurs ayant commencé avant l’âge de 12 ans. Ils étaient 23% en 1999 contre 50% en 2009. Alors que la consommation de tabac chez les jeunes garçons polynésiens s’avère bien inférieure à celle observée en métropole, les filles ont un niveau de consommation du même ordre et très supérieur à celui des garçons. De ce fait, l’intensité dépressive ainsi qu’une mauvaise moyenne scolaire apparaissent également très liés à l’expérimentation de tabac.
Pakalolo : très présent dans le quotidien des jeunes Polynésiens
Au global, l’expérimentation de paka concerne 29 % des jeunes Polynésiens, soit un tiers des garçons (33 %) et un peu plus d’un quart des filles (26 %). Par ailleurs, selon le CAST, échelle de repérage de l’usage problématique de cannabis, 13 % des garçons et 9 % des filles présenteraient un usage « à risque » de paka, tandis que respectivement 4 % et 2 % seraient déjà dans un usage problématique de ce produit. Comme cela est également observé en France métropolitaine, l’usage occasionnel du paka se révèle particulièrement lié aux opportunités de contact avec ce produit. En revanche, le basculement vers un usage problématique apparaît plus lié au niveau anxio-dépressif.
Les autres drogues rarement expérimentées
Les niveaux d’expérimentation des drogues illicites autres que le paka apparaissent bien inférieurs à ceux observés pour ce dernier. Lorsqu’elle a lieu, la rencontre avec les autres drogues se fait majoritairement après 16 ans. Là encore, leur expérimentation est associée à l’absentéisme scolaire et au niveau de dépression. Par ailleurs, elle concerne de manière plus importante les jeunes habitant dans les zones urbaines des Iles du vent.
En conclusion
Les résultats de cette enquête rejoignent pour beaucoup les constats des professionnels de terrain côtoyant les adolescents polynésiens. Ils montrent que l’usage de produits psychotropes a augmenté en dix ans, marquée par une hausse plus forte chez les filles, en particulier pour la consommation d’alcool. Une certaine baisse de l’âge d’entrée dans les consommations (voir l’ouvrage pour le détail) fait également écho aux observations de terrain, laissant supposer une banalisation de ces pratiques malgré une bonne connaissance des risques encourus. Ce point est important car la précocité du premier usage d’un produit est un facteur favorisant la poursuite de la consommation et l’installation d’un usage problématique.
Face à la constatation de l’augmentation de la consommation de tabac, d’alcool et de paka par les adolescentes polynésiennes en dix ans, il apparaît que le niveau de connaissances sur les risques ne fait pas défaut et que les messages de prévention véhiculés depuis plusieurs années ont été entendus. Mais ils se heurtent, dans cette société aux pratiques bien ancrées de consommation associée à la fête, à la disponibilité des produits et au fait que l’alcool et le cannabis apparaissent souvent comme le seul moyen de supporter les difficultés de la vie. Il est important, avant de se lancer dans des actions ciblant les filles, de les écouter pour mieux comprendre ce qui les poussent à vouloir consommer comme les garçons : place dans la société mal définie, moyen de s’imposer ou de se faire respecter, stress plus important ?
Dans le cadre du programme de lutte contre l’alcool et la toxicomanie de 2009, plusieurs pistes peuvent être préconisées afin d’endiguer la hausse de la consommation. Face aux demandes des élèves en matière d’information sur l’amélioration de la confiance en soi ou sur la gestion du stress, nos résultats confirment la nécessité de mettre en place le programme basé sur le développement des compétences personnelles et sociales pour une prévention plus large des déviances. Apprendre à gérer ses émotions et ses frustrations dès la petite enfance constitue en effet un moyen efficace d’aider les jeunes à ne pas basculer dans un usage à risque dans un pays où la honte de parler de soi et de ce que l’on ressent est parfois très forte. Des actions allant dans ce sens ont d’ailleurs été inscrites dans le programme de lutte contre l'alcool et la toxicomanie 2009-2013.
* Enquête ECAAP 2009 à télécharger sur : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1341.pdf
** contact référent santé : Dr Marie Françoise BRUGIROUX, Responsable du CCSAT
Tél 46 00 67 / Adresse mail : marie.francoise.brugiroux@sante.gov.pf
Références
[1] Beck F., Brugiroux M.-F., Cerf N. (dir.), Les conduites addictives des adolescents polynésiens. Enquête Ecaap 2009. Saint-Denis : Inpes, collection Études santé, 2010 : 200 p.
[2] Brugiroux M.-F. Les jeunes et la drogue : enquête CAP chez les jeunes scolarisés de 10 à 20 ans en Polynésie française. Papeete : ministère de la Santé, direction de la Santé, mars 2000 : 63 p.
« »
L'enquête a donné lieu a la diffusion d'un ouvrage volumineux et complet édité par l' INPES disponible ci-dessous en feuilletage ou en pièce jointe à télécharger:
« »