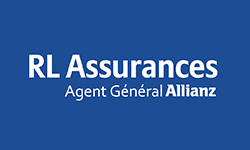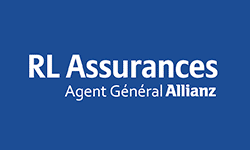Jacques Vernaudon, enseignant et chercheur en linguistique océanienne à l’Université de Polynésie française.
Si comme Goethe le pense "L’âme d’un peuple vit dans sa langue", il est utile de s'interroger sur la vivacité de la transmission du reo ma’ohi dans la société tahitienne moderne, sur la place de cette langue et sur son avenir.
Au cœur de cette réflexion : le rôle capital que doit jouer la relation intergénérationnelle, en famille. Entretien avec l'enseignant-chercheur en linguistique océanienne Jacques Vernaudon en guise d’introduction à l’exposé qu’il donne avec Mirose Paia, sur le thème "Langues polynésiennes et plurilinguisme : qu'avons-nous appris de dix ans d'enseignement expérimental en Polynésie française ?", dans le cadre des Conférences pour tous de l’Université, à Outumaoro, jeudi 15 octobre à 18 h 15.
Où en est la pratique du tahitien, aujourd’hui dans notre collectivité ?
Jacques Vernaudon : Les données dont on dispose sont éparses. Lors du dernier recensement général de la population, en 2012 (ISPF, ndlr), dans la classe d’âge des 15 ans et plus, la proportion des personnes qui déclarent comprendre, parler, lire et écrire une langue polynésienne est de 69%.
Evidement, c’est du déclaratif : à la question, les gens répondent oui ou non. Ils ne sont pas évalués. En habitant en Polynésie, on se rend bien compte que les langues polynésiennes sont en perte de vitesse. Et on peut supposer que cette donnée statistique correspond à une surestimation : les gens déclarent une compétence qu’ils n’ont pas forcément ; ou à un niveau qui n’est pas celui d’un locuteur qui parlerait parfaitement.
Selon ce recensement de 2012, seule 23% de la population de Polynésie française âgée de 15 ans et plus déclare parler le tahitien en famille. Réciproquement, ils sont 70% à déclarer parler français dans ce même cadre familial. Sur les îles du Vent, 42% des personnes âgées de 70 à 79 ans, 23% des 40-49 ans et 11% des 15-19 ans déclarent une langue polynésienne comme étant "la plus couramment parlée en famille", ce qui témoigne d’un étiolement de la pratique de la langue d’origine au cours des générations.
Quelle est, selon vous, la part de ceux qui parlent correctement ?
Jacques Vernaudon : La question est de savoir à partir de quand quelqu’un parle-t-il correctement ou pas une langue. Une personne qui sait tenir une conversation minimale sur des sujets très familiers doit-elle être comptabilisée comme locuteur ? Ou bien faut-il être en mesure d’aborder des sujets complexes ? Les linguistes et psycholinguistes qui travaillent sur ces questions-là estiment qu’à partir du moment où l'on utilise quotidiennement une autre langue, même si le niveau n’est pas très élevé, on est déjà en situation de bilinguisme. Et je pense qu’à Tahiti cela représente une proportion relativement importante de la population. Même les plus jeunes – que l’on n’entend pas forcément parler – ont souvent une compétence en compréhension : si on ne leur a pas parlé et transmis la langue, ils ont souvent entendu leurs parents ou grands-parents parler dans des situations diverses de vie.
Globalement, nous sommes en présence, aujourd’hui, de gens qui parlent et qui comprennent le tahitien – la génération la plus ancienne – ; de gens qui parlent peu parce qu’ils sont dans une forme d’insécurité linguistique ; et de gens – les plus jeunes – qui souvent comprennent mais ne se sentent pas armés pour parler.
Qu’est-ce qu’une telle situation nous laisse espérer quant à l’avenir du reo ?
Jacques Vernaudon : Compte tenu du fait que la génération des plus jeunes ne sera pas en mesure de parler à ses propres enfants, cela nous conduit assez inexorablement à une rupture.
Si on prend les échelles de l’Unesco au sujet de la vitalité des langues : au niveau de la transmission intergénérationnelle, on voit bien que la situation est critique ; concernant le critère de l’utilisation de la langue dans l’espace public, les espaces de la vie quotidienne où l'on parle tahitien se réduisent. Déjà, à l’aune de ces deux critères, selon la grille de l’Unesco, les langues polynésiennes sont en danger.
En danger, ça veut dire quoi pour une langue ?
Jacques Vernaudon : Que dans une génération, nous aurons des jeunes gens qui ne seront plus ni en situation de parler, ni de comprendre : si on ne fait rien, dans une génération nous aurons affaire à une langue morte.
De rares personnes continueront à parler, mais il s’agira d’une élite éduquée. Et la situation sera profondément injuste parce que les classes populaires, qui normalement sont les porteurs historiques de la langue, auront perdu ce capital. Au profit de quoi ? D’un français qui n’est même pas le français standard. Je ne jette pas l’opprobre sur le français local. Mais il se trouve que ce français-là n’est malheureusement pas celui qui permet d’obtenir des diplômes et accéder à un emploi.
N’est-ce pas paradoxal d’observer ce phénomène alors que tout le monde s’entend sur l’importance culturelle, patrimoniale, sociétale de la langue tahitienne ?
Jacques Vernaudon : On est face à deux mouvements contradictoires – nous avons d’ailleurs écrit, avec ma collègue Mirose Paia, un article sur le sujet, sous le titre "Le tahitien, plus de prestige moins de locuteurs". La reconnaissance sociale de la langue s’est accrue sans cesse depuis une quarantaine d’années. Quand on demande aux parents s’il est important d’enseigner le tahitien, 97% répondent que cela est "important" voire "très important".
Paradoxalement, en même temps de moins en moins d’adultes pratiquent cette langue avec leurs enfants.
Je pense que deux idées viennent perturber la transmission du tahitien. Une première est que, depuis les années 60, la langue de la réussite, c’est le français. (…) La deuxième – que j’appellerais l’idéologie monolingue – est la croyance selon laquelle un enfant ne pourrait apprendre qu’une seule langue à la fois. Et face au choix, on opte naturellement pour le français.
Ce que nous dit la littérature scientifique à propos du plurilinguisme, c’est qu’un enfant peut très précocement être exposé à plusieurs langues et les apprendre parfaitement. Il n’y a pas à choisir en somme. Les enfants sont parfaitement équipés pour recevoir plusieurs langues. Et c’est même souhaitable, pour leur développement cognitif.
Comment inverse-t-on une tendance lourde comme celle qui porte le tahitien vers sa disparition ?
Jacques Vernaudon : Il faut informer. Les parents doivent savoir quels sont les bons usages linguistiques en famille. C’est un enjeu sociétal d’ensemble. On a souvent fait peser ces questions-là sur les épaules de l’école. C’est vrai qu’elle a un rôle important à jouer, ne serait-ce que parce que c’est elle qui historiquement a véhiculé le principe du monolinguisme. Mais l’école ne peut pas tout. La transmission des langues passe aussi et surtout par l’engagement des familles. J’entends bien évidemment l’engagement de celles qui disposent encore du capital linguistique (…). Et il y en a. Mais encore faut-il que la société soit convaincue de ce choix-là. C’est vrai que le tableau que l’on dresse pourrait paraître sombre ; mais j’insiste sur le fait qu’aujourd’hui en Polynésie française, de nombreux adultes sont en mesure de parler aux enfants une langue polynésienne, parce qu’ils ont le capital linguistique.
Comment se situe-t-on, sur cette question de la langue, par rapport aux autres collectivités polynésiennes du Pacifique ?
Jacques Vernaudon : Aujourd’hui, en Nouvelle Zélande, le nombre de locuteurs du maori est de l’ordre de 4% sur la population globale, et c’est à peu près la même chose à Hawaii. La situation des langues en Polynésie française (il y en a sept différentes) est globalement moins dégradée. Ce n’est pas une raison de se satisfaire : on est aussi sur une pente descendante.
C’est aujourd’hui que nous devons décider si nous voulons que demain la population soit monolingue et ne parle que péniblement une autre langue comme l’anglais, apprise tardivement, ou si l’on fait le choix stratégique de transmettre nos langues à nos enfants. (…)
Quel intérêt en tire la collectivité ?
Jacques Vernaudon : Le plus immédiat est l’intérêt patrimonial. Il s’agit d’un capital culturel. Les principaux éléments de la culture sont véhiculés par le biais de la langue. Et j’insiste sur cet aspect patrimonial : il dépasse le simple ensemble polynésien. Les langues polynésiennes sont rattachées à l’ensemble linguistique austronésien qui prend lui-même ses racines en Asie du Sud-Est et qui s’étend jusqu’aux confins du Pacifique. Au plan des ramifications culturelles, c’est tout un univers.
Ensuite, il y une dimension identitaire dans la mesure où, appendre et parler une langue, c’est marquer son appartenance à une communauté. Lorsqu’on interroge les enfants qui ne savent pas parler le tahitien, ils reconnaissent volontiers pourtant que c’est leur langue. Et cette valeur identitaire ne doit pas être négligée : les gens déracinés sont des gens malheureux.
Le troisième critère, dont peu de gens parlent aujourd’hui, c’est le critère cognitif : parler deux ou trois langues précocement rend les enfants bilingues ou trilingues plus performants pour certaines tâches que s’ils étaient juste monolingues : ils sont plus aptes à apprendre de nouvelles langues ; leur surentrainement à gérer de l’information, du fait de leur plurilinguisme, leur donne des compétences accrues en matière d’attention sélective, notamment... Donc oui, les enfants bilingues en tirent un vrai bénéfice affectif, social, culturel et intellectuel.
Au cœur de cette réflexion : le rôle capital que doit jouer la relation intergénérationnelle, en famille. Entretien avec l'enseignant-chercheur en linguistique océanienne Jacques Vernaudon en guise d’introduction à l’exposé qu’il donne avec Mirose Paia, sur le thème "Langues polynésiennes et plurilinguisme : qu'avons-nous appris de dix ans d'enseignement expérimental en Polynésie française ?", dans le cadre des Conférences pour tous de l’Université, à Outumaoro, jeudi 15 octobre à 18 h 15.
Où en est la pratique du tahitien, aujourd’hui dans notre collectivité ?
Jacques Vernaudon : Les données dont on dispose sont éparses. Lors du dernier recensement général de la population, en 2012 (ISPF, ndlr), dans la classe d’âge des 15 ans et plus, la proportion des personnes qui déclarent comprendre, parler, lire et écrire une langue polynésienne est de 69%.
Evidement, c’est du déclaratif : à la question, les gens répondent oui ou non. Ils ne sont pas évalués. En habitant en Polynésie, on se rend bien compte que les langues polynésiennes sont en perte de vitesse. Et on peut supposer que cette donnée statistique correspond à une surestimation : les gens déclarent une compétence qu’ils n’ont pas forcément ; ou à un niveau qui n’est pas celui d’un locuteur qui parlerait parfaitement.
Selon ce recensement de 2012, seule 23% de la population de Polynésie française âgée de 15 ans et plus déclare parler le tahitien en famille. Réciproquement, ils sont 70% à déclarer parler français dans ce même cadre familial. Sur les îles du Vent, 42% des personnes âgées de 70 à 79 ans, 23% des 40-49 ans et 11% des 15-19 ans déclarent une langue polynésienne comme étant "la plus couramment parlée en famille", ce qui témoigne d’un étiolement de la pratique de la langue d’origine au cours des générations.
Quelle est, selon vous, la part de ceux qui parlent correctement ?
Jacques Vernaudon : La question est de savoir à partir de quand quelqu’un parle-t-il correctement ou pas une langue. Une personne qui sait tenir une conversation minimale sur des sujets très familiers doit-elle être comptabilisée comme locuteur ? Ou bien faut-il être en mesure d’aborder des sujets complexes ? Les linguistes et psycholinguistes qui travaillent sur ces questions-là estiment qu’à partir du moment où l'on utilise quotidiennement une autre langue, même si le niveau n’est pas très élevé, on est déjà en situation de bilinguisme. Et je pense qu’à Tahiti cela représente une proportion relativement importante de la population. Même les plus jeunes – que l’on n’entend pas forcément parler – ont souvent une compétence en compréhension : si on ne leur a pas parlé et transmis la langue, ils ont souvent entendu leurs parents ou grands-parents parler dans des situations diverses de vie.
Globalement, nous sommes en présence, aujourd’hui, de gens qui parlent et qui comprennent le tahitien – la génération la plus ancienne – ; de gens qui parlent peu parce qu’ils sont dans une forme d’insécurité linguistique ; et de gens – les plus jeunes – qui souvent comprennent mais ne se sentent pas armés pour parler.
Qu’est-ce qu’une telle situation nous laisse espérer quant à l’avenir du reo ?
Jacques Vernaudon : Compte tenu du fait que la génération des plus jeunes ne sera pas en mesure de parler à ses propres enfants, cela nous conduit assez inexorablement à une rupture.
Si on prend les échelles de l’Unesco au sujet de la vitalité des langues : au niveau de la transmission intergénérationnelle, on voit bien que la situation est critique ; concernant le critère de l’utilisation de la langue dans l’espace public, les espaces de la vie quotidienne où l'on parle tahitien se réduisent. Déjà, à l’aune de ces deux critères, selon la grille de l’Unesco, les langues polynésiennes sont en danger.
En danger, ça veut dire quoi pour une langue ?
Jacques Vernaudon : Que dans une génération, nous aurons des jeunes gens qui ne seront plus ni en situation de parler, ni de comprendre : si on ne fait rien, dans une génération nous aurons affaire à une langue morte.
De rares personnes continueront à parler, mais il s’agira d’une élite éduquée. Et la situation sera profondément injuste parce que les classes populaires, qui normalement sont les porteurs historiques de la langue, auront perdu ce capital. Au profit de quoi ? D’un français qui n’est même pas le français standard. Je ne jette pas l’opprobre sur le français local. Mais il se trouve que ce français-là n’est malheureusement pas celui qui permet d’obtenir des diplômes et accéder à un emploi.
N’est-ce pas paradoxal d’observer ce phénomène alors que tout le monde s’entend sur l’importance culturelle, patrimoniale, sociétale de la langue tahitienne ?
Jacques Vernaudon : On est face à deux mouvements contradictoires – nous avons d’ailleurs écrit, avec ma collègue Mirose Paia, un article sur le sujet, sous le titre "Le tahitien, plus de prestige moins de locuteurs". La reconnaissance sociale de la langue s’est accrue sans cesse depuis une quarantaine d’années. Quand on demande aux parents s’il est important d’enseigner le tahitien, 97% répondent que cela est "important" voire "très important".
Paradoxalement, en même temps de moins en moins d’adultes pratiquent cette langue avec leurs enfants.
Je pense que deux idées viennent perturber la transmission du tahitien. Une première est que, depuis les années 60, la langue de la réussite, c’est le français. (…) La deuxième – que j’appellerais l’idéologie monolingue – est la croyance selon laquelle un enfant ne pourrait apprendre qu’une seule langue à la fois. Et face au choix, on opte naturellement pour le français.
Ce que nous dit la littérature scientifique à propos du plurilinguisme, c’est qu’un enfant peut très précocement être exposé à plusieurs langues et les apprendre parfaitement. Il n’y a pas à choisir en somme. Les enfants sont parfaitement équipés pour recevoir plusieurs langues. Et c’est même souhaitable, pour leur développement cognitif.
Comment inverse-t-on une tendance lourde comme celle qui porte le tahitien vers sa disparition ?
Jacques Vernaudon : Il faut informer. Les parents doivent savoir quels sont les bons usages linguistiques en famille. C’est un enjeu sociétal d’ensemble. On a souvent fait peser ces questions-là sur les épaules de l’école. C’est vrai qu’elle a un rôle important à jouer, ne serait-ce que parce que c’est elle qui historiquement a véhiculé le principe du monolinguisme. Mais l’école ne peut pas tout. La transmission des langues passe aussi et surtout par l’engagement des familles. J’entends bien évidemment l’engagement de celles qui disposent encore du capital linguistique (…). Et il y en a. Mais encore faut-il que la société soit convaincue de ce choix-là. C’est vrai que le tableau que l’on dresse pourrait paraître sombre ; mais j’insiste sur le fait qu’aujourd’hui en Polynésie française, de nombreux adultes sont en mesure de parler aux enfants une langue polynésienne, parce qu’ils ont le capital linguistique.
Comment se situe-t-on, sur cette question de la langue, par rapport aux autres collectivités polynésiennes du Pacifique ?
Jacques Vernaudon : Aujourd’hui, en Nouvelle Zélande, le nombre de locuteurs du maori est de l’ordre de 4% sur la population globale, et c’est à peu près la même chose à Hawaii. La situation des langues en Polynésie française (il y en a sept différentes) est globalement moins dégradée. Ce n’est pas une raison de se satisfaire : on est aussi sur une pente descendante.
C’est aujourd’hui que nous devons décider si nous voulons que demain la population soit monolingue et ne parle que péniblement une autre langue comme l’anglais, apprise tardivement, ou si l’on fait le choix stratégique de transmettre nos langues à nos enfants. (…)
Quel intérêt en tire la collectivité ?
Jacques Vernaudon : Le plus immédiat est l’intérêt patrimonial. Il s’agit d’un capital culturel. Les principaux éléments de la culture sont véhiculés par le biais de la langue. Et j’insiste sur cet aspect patrimonial : il dépasse le simple ensemble polynésien. Les langues polynésiennes sont rattachées à l’ensemble linguistique austronésien qui prend lui-même ses racines en Asie du Sud-Est et qui s’étend jusqu’aux confins du Pacifique. Au plan des ramifications culturelles, c’est tout un univers.
Ensuite, il y une dimension identitaire dans la mesure où, appendre et parler une langue, c’est marquer son appartenance à une communauté. Lorsqu’on interroge les enfants qui ne savent pas parler le tahitien, ils reconnaissent volontiers pourtant que c’est leur langue. Et cette valeur identitaire ne doit pas être négligée : les gens déracinés sont des gens malheureux.
Le troisième critère, dont peu de gens parlent aujourd’hui, c’est le critère cognitif : parler deux ou trois langues précocement rend les enfants bilingues ou trilingues plus performants pour certaines tâches que s’ils étaient juste monolingues : ils sont plus aptes à apprendre de nouvelles langues ; leur surentrainement à gérer de l’information, du fait de leur plurilinguisme, leur donne des compétences accrues en matière d’attention sélective, notamment... Donc oui, les enfants bilingues en tirent un vrai bénéfice affectif, social, culturel et intellectuel.