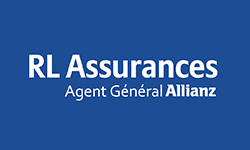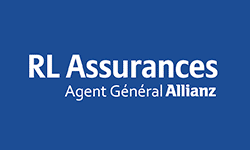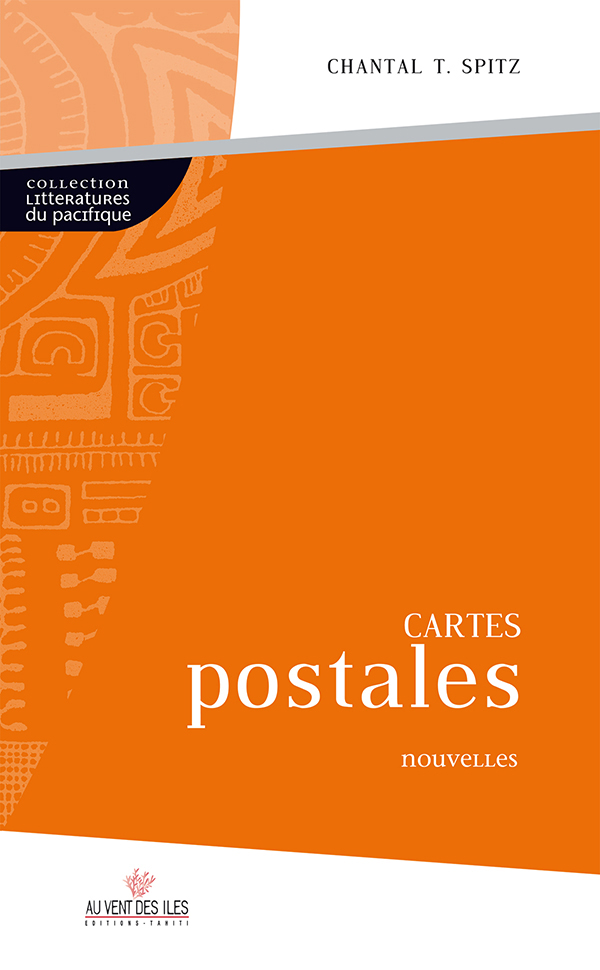PAPEETE, le 16 août 2016 - Quatre ans après Elles, terres d’enfances, son troisième roman polynésien, Chantal T. Spitz poursuit l’exploration des tréfonds de la société contemporaine avec un style littéraire viscéral et à la forme déstabilisante : sept nouvelles poétiques férocement douloureuses, aux antipodes du mythe de la Nouvelle-Cythère.
Elle, c’est Joséphine ou Lucien, mais c’est aussi Nadia, Rosalie, Nara’i ; une âme en vadrouille ou une réminiscence brumeuse d’un être aimé jadis. Sept nouvelles excessivement courtes pour explorer le quotidien dramatique des corps meurtris, des âmes en peine, des cœurs tourmentés ou nostalgiques et des gueules blafardes d’une société polynésienne métissée.
Société en proie à sa propre illusion de croire en un paradis moderne encore idyllique et préservé, qui ne cherche qu’à se conforter aux standards de la mondialisation et se rassurer au souvenir d’une société noble et intouchable. Alors qu’il s’en passe des vertes et des pas mûres à tous les coins de rue, dans toutes les servitudes, dans les soi-disant « bonnes familles », tout comme chez les moins bien lotis.
Je t’aime, moi non... plus
Pour reprendre la célèbre ambiguïté gainsbourienne, là où l’amour se perd, naît parfois la violence ; là où l’on croit deviner de l’amour, ne réside parfois que l’écume d’un remous ; là où l’amour physique s’évapore, se tisse un voile de souffrance... C’est bel et bien le quotidien de la douzaine de protagonistes qui s’enchaîne dans ces sept nouvelles, de quelques pages chacune. Un concentré de douleurs, souffrances, haines et ressentiments ; quête d’amour, d’argent, de bien-être ; recherche de rédemption, sauver les apparences sous des couches de maquillage, qui s'effritent pourtant sous la loupe impétueuse que porte Chantal T. Spitz sur cette réalité trop ignorée, facilement normalisée, voire banalisée.
Ainsi, elle donne la parole aussi bien aux victimes courroucées qu’aux agresseurs sans scrupule, aux tortionnaires machiavéliques et aux éclopés de la vie, ceux qui ont abandonné tout espoir et se réconfortent dans l'opulence matérielle ou se laissent sombrer jusqu’en enfer. Mais l’enfer, ce n’est pas que les autres, nous apprend l’auteure.
Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, on ne peut ignorer son talent littéraire et la force des sujets qu’elle dénonce. Si le lecteur ressort bouleversé de ces lectures, il ne peut en ressortir inchangé. Car si le talent de Chantal T. Spitz prend ici une forme atypique et innovante, c’est bien pour agiter les consciences d’un public parfois trop insensible aux faits divers qui jonchent pourtant les pages des quotidiens, au quotidien. Ne plus baisser la tête ni courber l’échine, accepter d’ouvrir les yeux sur la déchéance d’une partie de la société et sur la souffrance d’une grande majorité, c’est avant tout un acte d’altruisme et de compassion.
La désobéissance comme ultime forme de résistance
C’est avec une acuité presque philosophique que Chantal T. Spitz mène d’une main de maître le lecteur sur les pentes glissantes d’une réalité inavouable, où toute nouvelle histoire amène son lot d’interrogations, où les questions se retournent, en font jaillir d’autres bien plus dérangeantes, plus justes ou plus inattendues. "C’est une chose que tu as vue souvent. Somme toute, en haut comme en bas, tu trouveras les mêmes choses dont sont pleines les histoires, les anciennes, les modernes, les contemporaines", écrivait déjà Marc-Aurèle à l’aube de l’instauration de la démocratie populaire, où s’élevait la vox populi.
Ces nouvelles brutales, glauques et violentes rétablissent ainsi une certaine vérité sociale, celle fondée sur des rapports d’emprise et de domination, ambivalence réelle au-delà de toute limite raisonnable. Lorsqu’enfin, ponctuellement, la routine se rompt et que la victime sort de son état de soumission par désobéissance, les rôles s’inversent et alors "Ralph assommé de somnifères ligoté au lit conjugal dort du sommeil de l’injuste dans les flammes qui tordent et consument son corps", tel un amer retour à la réalité. Mais quelle réalité, au juste?
Au Vent des îles
Elle, c’est Joséphine ou Lucien, mais c’est aussi Nadia, Rosalie, Nara’i ; une âme en vadrouille ou une réminiscence brumeuse d’un être aimé jadis. Sept nouvelles excessivement courtes pour explorer le quotidien dramatique des corps meurtris, des âmes en peine, des cœurs tourmentés ou nostalgiques et des gueules blafardes d’une société polynésienne métissée.
Société en proie à sa propre illusion de croire en un paradis moderne encore idyllique et préservé, qui ne cherche qu’à se conforter aux standards de la mondialisation et se rassurer au souvenir d’une société noble et intouchable. Alors qu’il s’en passe des vertes et des pas mûres à tous les coins de rue, dans toutes les servitudes, dans les soi-disant « bonnes familles », tout comme chez les moins bien lotis.
Je t’aime, moi non... plus
Pour reprendre la célèbre ambiguïté gainsbourienne, là où l’amour se perd, naît parfois la violence ; là où l’on croit deviner de l’amour, ne réside parfois que l’écume d’un remous ; là où l’amour physique s’évapore, se tisse un voile de souffrance... C’est bel et bien le quotidien de la douzaine de protagonistes qui s’enchaîne dans ces sept nouvelles, de quelques pages chacune. Un concentré de douleurs, souffrances, haines et ressentiments ; quête d’amour, d’argent, de bien-être ; recherche de rédemption, sauver les apparences sous des couches de maquillage, qui s'effritent pourtant sous la loupe impétueuse que porte Chantal T. Spitz sur cette réalité trop ignorée, facilement normalisée, voire banalisée.
Ainsi, elle donne la parole aussi bien aux victimes courroucées qu’aux agresseurs sans scrupule, aux tortionnaires machiavéliques et aux éclopés de la vie, ceux qui ont abandonné tout espoir et se réconfortent dans l'opulence matérielle ou se laissent sombrer jusqu’en enfer. Mais l’enfer, ce n’est pas que les autres, nous apprend l’auteure.
Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, on ne peut ignorer son talent littéraire et la force des sujets qu’elle dénonce. Si le lecteur ressort bouleversé de ces lectures, il ne peut en ressortir inchangé. Car si le talent de Chantal T. Spitz prend ici une forme atypique et innovante, c’est bien pour agiter les consciences d’un public parfois trop insensible aux faits divers qui jonchent pourtant les pages des quotidiens, au quotidien. Ne plus baisser la tête ni courber l’échine, accepter d’ouvrir les yeux sur la déchéance d’une partie de la société et sur la souffrance d’une grande majorité, c’est avant tout un acte d’altruisme et de compassion.
La désobéissance comme ultime forme de résistance
C’est avec une acuité presque philosophique que Chantal T. Spitz mène d’une main de maître le lecteur sur les pentes glissantes d’une réalité inavouable, où toute nouvelle histoire amène son lot d’interrogations, où les questions se retournent, en font jaillir d’autres bien plus dérangeantes, plus justes ou plus inattendues. "C’est une chose que tu as vue souvent. Somme toute, en haut comme en bas, tu trouveras les mêmes choses dont sont pleines les histoires, les anciennes, les modernes, les contemporaines", écrivait déjà Marc-Aurèle à l’aube de l’instauration de la démocratie populaire, où s’élevait la vox populi.
Ces nouvelles brutales, glauques et violentes rétablissent ainsi une certaine vérité sociale, celle fondée sur des rapports d’emprise et de domination, ambivalence réelle au-delà de toute limite raisonnable. Lorsqu’enfin, ponctuellement, la routine se rompt et que la victime sort de son état de soumission par désobéissance, les rôles s’inversent et alors "Ralph assommé de somnifères ligoté au lit conjugal dort du sommeil de l’injuste dans les flammes qui tordent et consument son corps", tel un amer retour à la réalité. Mais quelle réalité, au juste?
Au Vent des îles
Chantal T. Spitz, une plume acérée à l’encre sympathique
Née en 1954 à Paofai, Chantal T. Spitz a mené une carrière d’enseignante et réside désormais à Huahine. En 1991, elle a signé de sa plume singulière le premier roman polynésien, L’île des rêves écrasés, réédité par Au vent des îles en 2003, suivi de plusieurs autres depuis, notamment Elles, terre d’enfance - Roman à deux encres (2011) ou encore Hombo, transcription d’une biographie (réédité en 2012). Elle présente ici son premier recueil de nouvelles, au style particulièrement recherché et inhabituel dans l’univers pourtant sans limite de la littérature contemporaine. Elle participe à l’aventure littéraire de l’Association Littérama’ohi qui édite des ouvrages à plusieurs mains, en français et en tahitien, et qui s’attache à faire vivre l’écrit pour mieux se souvenir, se rappeler de la culture d’antan tout en la confrontant à la réalité moderne. Son style atypique est ponctué de tradition orale polynésienne, négligeant la ponctuation classique et les majuscules, inutiles pour briser les phrases afin de se concentrer sur le seul contenu important du texte, ainsi que sur la force exaltante des mots scrupuleusement choisis. La musique vient donc en lisant l’encre indélébile de sa prose, en s’écorchant aux mots qui deviennent sentences : c’est ainsi que l’on apprend à lire entre les lignes de cette auteure brillante qui, comme Baudelaire, a tout du poète maudit, renié par ses contemporains, mais adulé par la suite. Condition nécessaire pour oser assumer ceux que beaucoup préfèrent habituellement taire sur les cartes postales de vacances.
Née en 1954 à Paofai, Chantal T. Spitz a mené une carrière d’enseignante et réside désormais à Huahine. En 1991, elle a signé de sa plume singulière le premier roman polynésien, L’île des rêves écrasés, réédité par Au vent des îles en 2003, suivi de plusieurs autres depuis, notamment Elles, terre d’enfance - Roman à deux encres (2011) ou encore Hombo, transcription d’une biographie (réédité en 2012). Elle présente ici son premier recueil de nouvelles, au style particulièrement recherché et inhabituel dans l’univers pourtant sans limite de la littérature contemporaine. Elle participe à l’aventure littéraire de l’Association Littérama’ohi qui édite des ouvrages à plusieurs mains, en français et en tahitien, et qui s’attache à faire vivre l’écrit pour mieux se souvenir, se rappeler de la culture d’antan tout en la confrontant à la réalité moderne. Son style atypique est ponctué de tradition orale polynésienne, négligeant la ponctuation classique et les majuscules, inutiles pour briser les phrases afin de se concentrer sur le seul contenu important du texte, ainsi que sur la force exaltante des mots scrupuleusement choisis. La musique vient donc en lisant l’encre indélébile de sa prose, en s’écorchant aux mots qui deviennent sentences : c’est ainsi que l’on apprend à lire entre les lignes de cette auteure brillante qui, comme Baudelaire, a tout du poète maudit, renié par ses contemporains, mais adulé par la suite. Condition nécessaire pour oser assumer ceux que beaucoup préfèrent habituellement taire sur les cartes postales de vacances.